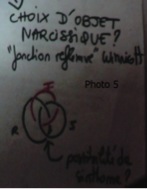Séminaire de préparation du Séminaire d’été
Mardi 15 décembre 2015
Les Écrits techniques de J. Lacan, Leçons IX et X par Elsa Caruelle-Quilin.
Elsa Caruelle — On voit le début en tout cas (la feuille de schémas est projetée au mur). On part de là, du centre.

Suite à l’effort de Marie-Christine Laznik il y a quinze jours, je vais essayer moi aussi de nouer les deux séminaires, enfin surtout le premier et puis les derniers séminaires borroméens. Par contre à la différence de Marie-Christine Laznik, vous avez vu qu’elle a essayé de rendre compte d’un tressage, c’est-à-dire de la constitution même du nœud. Je vais quant à moi partir d’un Triskel originaire, un triskel fondamental, soit de la question du trois comme originaire, c’est-à-dire comme antécédent à toute nomination des registres. Parce que par compte pour faire une tresse il va falloir dire que R passe sur S… donc il va falloir nommer. Donc un trois qui serait peut-être ce que Winnicott appelait la « nature humaine » ou ce que les théoriciens de l’attachement repèrent dans le réflexe du grasping. Vous savez que les nouveaux théoriciens, ils repèrent des choses presque innées, je ne crois pas que ce soit inné, mais bon, en tout cas c’est déjà là à la naissance. Le petit homme ne serait pas une table rase à la naissance, il serait d’emblée « triskelique », et c’est précisément cette naissance que Robert va remettre en jeu. Donc nous pourrons, bien sûr, discuter de cette histoire du triskel originaire, mais j’ai besoin de poser cet axiome pour développer la suite. Et pour pouvoir poser des questions donc on pourra revenir éventuellement là-dessus sachant que Thatyana a déjà défendu cette hypothèse ici, on pourra en discuter. Donc je vous propose de vous centrer plus particulièrement sur le cas clinique, c’est-à-dire sur la Leçon IX, même si on va reprendre quand même la Leçon X, Pour introduire le narcissisme et puis tous les textes de Freud la « Répétition, remémoration et perlaboration », tous ces textes qui sont abordés là dans les leçons.
Lacan introduit la Leçon IX par l’évocation de l’article de Freud sur « l’amour de transfert ». Le transfert est une question centrale du séminaire, défini comme résistance à la parole pleine, comme sentiment vécu de la présence de l’analyste, comme interruption de la fonction symbolique. Or précisément, ce sentiment de la présence on peut dire que Robert ne l’a pas vécu. Sa mère négligea les soins essentiels jusqu’à oublier de le nourrir, nous reviendrons sur ce biberon réel dont nous verrons qu’il sera un objet central de la cure. Biberon réel donc parce qu’oublié, ni donné par la mère ni demandé par l’enfant. À cinq mois, Robert est hospitalisé dans un état de dénutrition, à onze mois il est abandonné par sa mère. Il s’ensuit vingt-cinq changements de résidence, sans jamais de placement nourrissier. C’est donc bien la question de l’amour de transfert qui va se poser dans la cure de Robert. Soit la question même de l’amour si l’on suit Freud dans son article. Il ne va pas distinguer puisqu’il va dire que le transfert c’est l’amour.
Comme le dit Winnicott : « Un bébé sans sa mère ça n’existe pas ». Je dis bien sa mère, c’est-à-dire une mère et non pas la mère. La mère c’est comme La femme ça n’existe pas. Je vous dis ça parce que ça va poser question dans le signifiant « Madame ». Ce qui existe donc ce n’est pas la mère c’est un petit autre incarné, une mère suffisamment bonne, une maman. Un bébé sans sa mère, un bébé sans amour, ça n’existe pas. Cet amour qui est – si je cite Freud dans … l’amour de transfert – « dans son mode le plus radical phénomène du transfert au niveau de l’échange symbolique ». Il va s’agir de cerner, je cite Lacan dans la leçon, « la nature de cet amour de transfert au sens le plus précis, le plus affectif. » Cette question économique de l’affect c’est notamment ce qui distingue Robert de Dick. Puisqu’on a vu que Robert est très agité alors que Dick est très calme. C’est aussi toute la question de la Behajung en tant que régie par le principe de plaisir qui – si j’ai bien compris le texte de Freud – est avant tout une question économique. Freud s’est toujours intéressé à la question économique de l’affect que ce soit dans l’innervation de l’affect dans le corps de l’hystérique ou encore dans l’abréaction des affects dans l’hypnose, que ce soit aussi dans l’agir et le revécu comme résistance à la remémoration(1). Dans les débuts du séminaire il y a aussi cette question de la disjonction, de l’affect et de l’intellect dans la Verneinung. La question économique apparaît dans le cas de Robert que je vous présente comme centrale. Robert est dans une agitation constante avec une grande incoordination motrice et des crises clastiques. La constitution d’une Behajung chez Robert a d’emblée été effractée par le débordement économique de la douleur, par la quantité non liée d’excitation qui empêche la mise en place du principe de plaisir qui régit et la Behajung et l’Ausstossung. Robert a subi plusieurs opérations et des perturbations somatiques très douloureuses, notamment aux oreilles. On pourrait ici évoquer le texte de Freud, Le problème économique du masochisme(2). Le problème économique de la douleur a probablement entraîné un évidement projectif, donc là on va partir du triskel, on voit un peu ou pas ?

Le problème économique de la douleur a probablement entraîné un évidement projectif infini des quantités non liées pour satisfaire au principe de plaisir à moins qu’on ne soit même en deçà du principe de plaisir dans le mythique principe de nirvâna. Il n’y a pas de monde extérieur parce qu’il n’y a pas de monde intérieur, à moins que ce ne soit l’inverse. Cette projection à l’infini – puisque vous voyez que le triskel va partir là à l’infini– c’est mon hypothèse, c’est juste pour essayer qu’on fasse des nœuds borroméens ; cette projection à l’infini de contenu mauvais ne fait retour par aucune expérience de plaisir c’est-à-dire de liaison, sans parexcitation, sans nomination maternelle. Reste une Ausstossung sans retour sans traces d’angoisse ni de culpabilité, nous dit Rosine Lefort, sans traces tout court ajouterons-nous, c’est-à-dire sans Behajung, puisque nous le verrons, seul le plaisir fait trace. Robert comme nombre d’enfants psychotiques est avalé par le dehors d’un triskel centripète, éjecté par les portes ouvertes, le déshabillage ou le vidage du pot. Cette ouverture sur l’infini qui recrache son corps dans les crises clastiques, je vous propose de l’appeler « le loup ». Et donc je vous propose de partir du triskel central.
Pierre-Christophe Cathelineau — Le Loup c est… redites ce que vous venez de dire…
E. Caruelle — Le loup, il va varier beaucoup ce signifiant, donc au départ je propose qu’on parte du triskel. Voilà, c’est-à-dire que le loup… centripète, vous voyez on le voit là.
Cette semaine j’ai regardé un reportage de Marguerite Duras, c’est un documentaire qui s’appelle « « Savannah Bay« (3), c’est toi » et il y a quelque chose qui m’a interpellée. Je vous donne la citation, je ne sais pas ce qu’il faut en faire mais… donc elle dit : « La petite fait, fabrique sa venue au monde, son enfance. Une mère, un père, un amour puisqu’il en faut, puisque c’est impossible de s’en passer. Il n’y a pas d’orphelins, il y a des gens sans imaginaire ». Voilà, c’est ce que je vais tenter d’illustrer avec le cas Robert.
Dans la Leçon X Lacan revient sur, je cite : « la névrose en tant qu’elle a noué dans ses fils la personne imaginaire de l’analyste ». C’est toute la question qui va se jouer dans la cure de Robert puisque comme le précise Freud dans Pour introduire le narcissisme – qui est aussi cité dans les leçons – cette substitution dans la névrose n’a pas lieu dans la psychose ou alors seulement dans un second temps. Ce sont ces deux temps que nous allons tenter de suivre dans la cure avec Rosine Lefort, deux temps d’un Autre à l’autre c’est-à-dire du grand Autre au petit autre. Notre hypothèse c’est que c’est moins le grand Autre que le petit autre qui pose question dans cette psychose et peut-être c’est notre hypothèse dans toute psychose. Avant le traitement, Rosine décrit Robert comme dépourvu de toute parole sans – je cite – « vrais contacts », donc elle précise qu’il est dépourvu de toute parole mais il n’est pas dépourvu de langage, il crie « Madame » et « le Loup ». Et ce signifiant « Madame » il n’a pas du tout été repris dans la leçon, ça m’a arrêtée quand même. Parce que pour un enfant de cet âge. Je ne sais plus quel âge il a ?
P.-Ch. Cathelineau — Quatre ans.
Hubert Ricard — Pas tout à fait quatre ans.
E. Caruelle — En général, à cet âge-là on dit « Maman ». C’est quand même curieux ! Moi ça m’a arrêtée. Je vais vous proposer une hypothèse. Madame donc et non pas Maman. Robert est hospitalisé à cinq mois pour dénutrition mais il sera aussi soigné pour anorexie. Peut-on faire l’hypothèse…, donc là on va remonter

Peut-on faire l’hypothèse d’une défense anorexique, d’une stase défensive contre le triskel qui recrache une détresse infinie du nourrisson ? C’est-à-dire peut-on faire l’hypothèse que face à l’afflux d’excitation non liée, dans la faim et dans la douleur qui effractent toute liaison du moi plaisir purifié, peut-on faire l’hypothèse donc d’une mutilation défensive de I ? C’est-à-dire du petit autre mais aussi du corps de Robert qui ne sera alors plus qu’un organisme, que I éjecté dans le réel ? Un organisme dans le réel, c’est-à-dire au mécanisme d’éjection près, en tant que si l’éjection aboutissait réellement, c’est-à-dire si elle était sans retour, ce serait la mort pour cet organisme. Donc mon hypothèse c’est que ce détachement de I c’est pas tout à fait vrai que c’est un organisme dans le réel puisqu’on voit qu’il va avoir beaucoup de perturbations somatiques, etc., en fait, c’est pas seulement I détaché comme ça, là, éjecté… c’est pas seulement un organisme non lié, non noué, c’est un organisme délié, dénoué c’est-à-dire désérotisé. Les pulsions d’autoconservation donc dans le texte toujours Pour introduire le narcissisme…
M.-Ch. Laznik — Désérotisé ou anérotisé ?
E. Caruelle — Si on parle du triskel central mais on pourra en discuter puisque justement je vous ai citée au début, on n’est pas d’accord sur le départ mais je pense qu’en tout cas c’est défensif, c’est ça que je veux dire, ça ne fait pas un organisme par exemple animal, ça fait un organisme humain détaché, ce n’est pas la même chose que l’animal, je ne sais pas comment dire ça.
H. Ricard — Juste un petit mot pour m’éclairer parce que j’ai dû manquer quelques leçons mais le triskel, vous, vous le représentez comme les trois registres non noués encore, c’est ça ?
E. Caruelle — Si, si ! Ils sont noués mais seulement ils partent à l’infini, c’est-à-dire il n’y a pas de liaison, on va voir ça…
H. Ricard — Je me permets de poser cette question parce que Lacan identifie le triskel dans R.S.I. à l’idéal et il dit que c’est à partir de la nomination des trois registres que s’effectue le nœud borroméen, alors je voudrais savoir, concrètement, ce que ce que vous appelez le triskel. Est-ce que c’est en rapport avec ce qu’il avait dit ou…
E. Caruelle — Non, moi je pense qu’on nait dans le trois, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’abord le réel, l’imaginaire, le symbolique, c’est que d’emblée il y a un trou central, ce que d’ailleurs témoignent les bébés, ce ne sont pas des bébés animaux, avec un réflexe, on va dire de… C’est pour ça que j’ai pensé au grasping, ça peut se discuter parce que je n’y connais pas grand-chose à cette théorie de l’attachement, mais dans le sens où il y a une tension vers l’extérieur immédiate des bébés avec une expulsion que nous a très bien expliqué Marie-Christine Laznik, d’emblée vers le dehors. Bon, mais on peut discuter…
Les pulsions d’autoconservation sont, dès l’origine, indistinctes de la libido, si on suit Freud dans Pour introduire le narcissisme. L’autoconservation est donc menacée chez Robert puisqu’il va y avoir anorexie et dénutrition sévère, elle est menacée par la mise hors circuit du principe de plaisir. Peut-on entendre le refus de la maman au sens du génitif objectif puisqu’il va dire « Madame », comme le refus défensif de l’incarnation de l’Autre, lui qui n’a été nourri que par des « Madame ». « Madame » ce signifiant désincarné c’est-à-dire non barré, ce n’est pas, nous le verrons, la mère phallique. Madame et non pas maman n’est pas marquée par l’interdit de l’inceste, c’est l’image primordiale d’un autre non barré, détenteurs d’objets réels non symbolisés comme le biberon, le caca, mais nous le verrons dans la cure, le pénis et non pas le phallus. Madame donc et non pas Maman, I non troué et dénoué rejeté au-dehors. Madame donc serait le retour de I dans le réel puisque selon la formule canonique « ce qui est forclos du symbolique fait retour dans le réel ». Car un refus – puisque je suppose que c’était un refus de « Maman » –, ça n’est pas rien. De ce refus de I, ce n’est pas comme si c’était juste détaché, c’est éjecté, le couple R S conserve la trace puisque vous voyez qu’ils ne sont pas en continuité quand même… il y a quand même quelque chose qui reste de la consistance. Il conserve la trace de ce refus dans la consistance même du mot loup qui persiste. La consistance de S qui double le réel et nomme tout. Donc R est accouplé avec S, il y aurait donc une solidarité topologique entre la stase du langage dans ce signifiant totalitaire car « loup » c’est tout, c’est lui, c’est l’autre, tout est « loup ». Une solidarité topologique entre ce signifiant totalitaire et une image primordiale inentamée. Je ne sais pas s’il faut écrire ça comme ça, mais « Le loup » égale « madame » c’est-à-dire que le couple (R, S) égale I non barré. C’est la même chose topologiquement parlant. Il n’y a pas d’équivalence – puisque vous savez que Mélanie Klein a beaucoup parlé des équivalences qui permettent de passer d’un signifiant à un autre – qui ait permis l’élargissement du monde objectal, comme on l’a vu chez Mélanie Klein ou du trésor des signifiants pour parler en termes lacaniens. « Le loup » est quasi hallucinatoire en tant qu’il nomme un pur réel sans réalité puisque donc il n’y a pas I. C’est-à-dire qu’il nomme tout et n’importe quoi. On pourrait dire que « le loup » est un signifiant pur, une langue morte, c’est-à-dire hors transfert, à ceci près, que le mot « Madame » signe un retour, une présence de I dans le réel plus qu’une absence de I. « Madame » serait le retour de la forclusion de I dans le réel. Il n’y a pas de nœud à deux. Ce refus de la mère au sens génitif objectif et subjectif, puisque ça a marché dans les deux sens, entraîne Robert dans une anorexie du nourrisson. Il finit par être hospitalisé réduit à un organisme non troué, nourri à la sonde, ce qui interroge sur la possibilité même d’une satisfaction hallucinatoire puisque donc il n’y a pas d’absence de l’objet.
M.-Ch. Laznik — Vous avez tout à fait raison parce qu’il n’y a pas de temps de fin dans ces cas-là.
E. Caruelle — C’est ça. Je fais l’hypothèse que le sentiment vécu de la présence de Rosine provoque ce qu’on pourrait appeler une psychose de transfert, c’est-à-dire la relance du tourbillon et retour au triskel vous voyez que comme s’il y avait une défense et puis retour. La relance du tourbillon autour du « le loup ! » Cette réactivation de l’évidement – puisqu’on va voir ça tout de suite, par toutes les portes, par tous les trous – serait provoquée par la présence même de « Madame », c’est-à-dire I non troué qui, pourvu des objets réels du besoin, va tenter de réincarner « Maman », c’est-à-dire de renouer I. Le trou du triskel semble recracher automatiquement le corps de Robert à l’infini. Robert, en présence de Rosine renoue avec Madame pour déboucher sur le signifiant « maman ». Ce refus ce n’est pas l’indifférence de Dick, Robert s’engouffre d’emblée dans la relance de la stase du langage vers le verbe incarné. Si Dick était peut-être… – alors ça, je ne sais pas, je veux bien en discuter mais… – je me suis dit que peut-être Dick… voyez dans le mouvement centripète, là, du triskel, c’est-à-dire qui va vers l’extérieur… – je pense que c’est ça ? – je me suis demandé si Dick n’était pas dans un mouvement centrifuge, c’est-à-dire de rétractation des pseudopodes au lieu de… et que ça…
Marc Darmon — C’est le contraire…
E. Caruelle — C’est-à-dire ?
M. Darmon — Centrifuge, c’est du centre vers l’extérieur.
P.-Ch. Cathelineau — C’est l’inverse.
E. Caruelle — D’accord ! C’est l’inverse ! Bon alors, c’est l’inverse. Voilà, c’est ce que je veux dire, c’est-à-dire que Robert, il est caractérisé par une extériorisation, ce qui n’est pas le cas de Dick. D’accord, donc c’est l’inverse.
P.-Ch. Cathelineau — C’est centrifuge.
E. Caruelle — Centrifuge, c’est vers l’extérieur ?
P.-Ch. Cathelineau — C’est centrifuge vers l’extérieur.
H. Ricard — C’est la fuite hors du centre.
E. Caruelle — D’accord.
P.-Ch. Cathelineau — C’est un loup centrifuge.
E. Caruelle — Oui, pas centripète ! O.K. Si Dick était peut-être une rétractation donc centripète des pseudopodes de l’animalcule, on ne peut que distinguer Robert du négativisme de Dick qui regardait Mélanie Klein comme si elle était un meuble. Ce n’est pas du tout le cas de Robert. C’est pourtant aussi la question de l’incarnation que vise Mélanie Klein dans sa greffe d’Imaginaire : Papa grand train, Dick petit train, Maman station. Elle incarne, c’est-à-dire qu’elle barre les signifiants, c’est-à-dire qu’elle passe du grand Autre au petit autre. Que ce soit Mélanie Klein ou Rosine Lefort, je cite Lacan :
« C’est dans la mesure où elle parle que quelque chose se produit et précisément, qu’est-ce que c’est que cette parole si obscène, cette parole si bête peut-être même parfois ? Qu’est-ce que noue cette parole des analystes d’enfants au regard du dénuement du discours sans parole, au regard du dénuement du silence des analystes d’adultes ? Est-ce la même question que Freud se posait, à la fin de son œuvre, quant aux constructions en analyse ? »
Il va s’agir de distinguer nettement le plan de la parole du plan du langage, nous dit Lacan, même si nous apprendrons cette année, dans Le moment de conclure, que le langage, ça n’existe pas, que ça n’est qu’un idéal, idéal freudien sur lequel nous ne pourrons pas ne pas interroger notre technique. Ce qui fait donc, selon Freud, résistance à la remémoration, c’est la répétition, c’est l’agir. Ce qui est cité là c’est dans Remémoration, répétition et perlaboration. La résistance, pour Freud, n’est que l’échec de l’idéal, de la restauration des souvenirs, l’impuissance du primat du Symbolique. Après les séminaires borroméens, je crois qu’on peut dire que la résistance c’est le nœud. L’Imaginaire c’est effectivement ce qui fait non-rapport, ce qui résiste entre R et S.
Comme le montre effectivement la première leçon du Moment de conclure – puisqu’on va retrouver ce schéma qui est tout en haut, dans la première leçon du Moment de conclure, comme idéal freudien, dira Lacan – comme le montre effectivement la première leçon du Moment de conclure, l’idéal freudien et peut-être même – je vous le propose – l’idéal de tout discours, c’est la saisie du Réel, c’est le couple RS, c’est-à-dire ce qui fait sauter la question économique de l’affect. L’agir est, pour Freud, je cite, une façon de se remémorer et, effectivement, c’est dans ce sens que va travailler Rosine Lefort. Elle travaille à une historicisation, celle-là même que nous n’avons de cesse de défaire dans une psychanalyse d’adulte, même si – quoi qu’on en dise – un adulte qui ne parle pas de son enfance c’est louche et surtout c’est difficilement maniable. Mais ne peut-on pas repérer, chez les analystes, l’idéal obsessionnel qu’il y aurait à se défaire de cette incarnation du trauma, à se défaire – c’est mon hypothèse – de I comme non-rapport RS ? Ne peut-on repérer l’idéal à atteindre d’une interprétation juste ? Qui n’a pas déjà dit à son patient : mais oui, c’est tout à fait ça ?
Dans la leçon X, Lacan rappelle que « la règle fondamentale donne, je cite, pour consigne l’objet d’une parole aussi dénouée que possible – c’est dans le Séminaire I – de toute supposition de responsabilité, qu’elle libère même le sujet de toute exigence d’authenticité… ». Peut-on aller jusqu’à dire que la règle fondamentale libère de toute saisie du Réel en tant qu’il ne s’agit pas de dire quelque chose, en tant qu’il s’agit peut-être de parler pour ne rien dire ? C’est-à-dire que S – enfin, vous voyez que c’est comme ça que S se détache de la question de la saisie de R –, ce qui provoquerait automatiquement la présence de l’Imaginaire puisque c’est équivalent, c’est-à-dire que s’il y a un non-rapport entre R et S, il y a I qui surgit, c’est-à-dire ce qui provoquerait le sentiment vécu de la présence de l’analyste et pose le problème crucial de l’interprétation comme refaisant le nouage RS.
Si, dans le cas de Robert, cette question de la résistance c’est-à-dire, selon Freud, la question de l’abréaction des affects – parce que c’est très présent chez Robert – donc si, dans le cas de Robert, ça pose la question d’un début d’analyse, la question n’est pas, pour nous, sans poser tout aussi bien la question de la fin d’une analyse, c’est-à-dire la question de la fin du primat du Symbolique. Pouvons-nous, après les nœuds borroméens, continuer de penser l’affect et l’Imaginaire comme la résistance à abattre par le primat du Symbolique ou cela va-t-il demander des remaniements techniques ? Après L’Amour aux temps du choléra, nous faudra-t-il écrire « l’amour aux temps du nœud borroméen » ?
P.-Ch. Cathelineau — C’est comme le choléra…
E. Caruelle — C’est la peste ! Oui, c’est le temps de la peste.
Mélanie Klein fait consister l’Imaginaire dans l’espace, Rosine va le faire consister dans le temps. Dans les équivalences, donc elle va mettre en place répétition-remémoration, puisqu’elle va interpréter. Donc, dans les équivalences répétition-remémoration, chez Lefort comme chez Freud, on peut retrouver, dans le temps, la relance des équivalences dans l’espace provoquées par Mélanie Klein dans le cas Dick : équivalences imaginaires ou symboliques – puisque ça va être discuté dans la leçon IX – entre répétition et remémoration du passé ? C’est toute la question de la tentation paranoïaque de l’histoire qui s’ouvre, la question de la différence entre une métaphore et une métonymie.
Pour que se fasse la disjonction – je me suis moi-même beaucoup centrée sur Pour introduire le narcissisme – entre pulsions d’autoconservation et pulsions sexuelles – d’après ce que j’ai compris mais on pourra en discuter – il faut qu’un bébé renonce à la satisfaction hallucinatoire du désir, c’est-à-dire qu’il accepte l’au-delà du principe de plaisir. Il faut qu’il renonce à l’hallucination pour appeler et retrouver un objet perdu qui ne sera donc pas le bon. Il pourrait dire : ce n’est pas ma mère. Je pense que c’est là qu’intervient la Verneinung, c’est-à-dire qu’il perd l’hallucination et il cherche un objet qui ne sera donc pas hallucinatoire. C’est dans ce renoncement à la satisfaction hallucinatoire que s’enclenchent les répétitions et les équations symboliques, c’est-à-dire ratées, au-delà du principe de plaisir. Là seulement Robert aurait pu dire : ce n’est pas ma mère, ce n’est pas le bon sein. Ce renoncement exige une confiance en la rythmicité et en la prévisibilité, en la permanence de l’objet sur quoi insiste beaucoup Rosine Lefort pour Robert qui a subi une grande discontinuité et une arythmicité des soins. Rosine Lefort donc repart de l’objet du besoin, de l’objet réel, c’est-à-dire qu’elle va insérer, à l’intérieur de la séance, le biberon mais aussi le caca qui va être là et puis même il va y avoir aussi cette histoire de pénis… enfin, bon, quand même ! C’est-à-dire que ces objets vont intervenir réellement dans la cure. Elle tente de relancer un choix d’objets par étayage, c’est-à-dire de passer de la privation réelle à la frustration, du biberon réel au biberon de la demande. Que signifie, pour Robert, la présence de ces objets dans la séance, si ce n’est la présence d’un Autre primordial, la Madame incluant l’objet ? Je vous dis ça parce que… bon, je soigne des enfants mais je pense qu’il y en a d’autres ici et je ne connais personne qui fasse encore ça mais peut-être qu’il y a des gens qui… c’est-à-dire qu’il y a très peu d’analystes d’enfants qui travaillent avec des biberons ou… je veux dire qu’on a plutôt fait une autre tentative [à partir de laquelle] j’essaierai de faire une hypothèse. C’est-à-dire que c’est quand même caractéristique de cette technique d’avoir introduit ces objets réels. Qui parmi les analystes d’enfants travaillent encore avec de tels objets ? Contrairement à Klein, Lefort ne joue pas. Pourquoi choisissons-nous – les analystes d’enfants – le jeu pour la plupart d’entre nous ? Donc, c’est mon hypothèse. Lefort mise sur le choix d’objets par étayage alors que le manque n’est pas symbolisable… ce qu’on verra. Lefort tente de relancer la question pulsionnelle là où Mélanie Klein fait une greffe d’Imaginaire. J’ouvre donc cette question entre le choix d’objets par étayage et le choix d’objets narcissiques comme alternative donc abordée par Freud, dans Pour introduire le narcissisme, mais aussi parce que… c’est ce que je vais essayer de montrer :

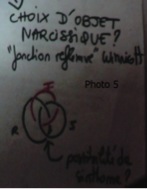
Mon idée c’est qu’en fait Rosine Lefort va tenter un choix d’objets par étayage ce qui condamne du coup – à mon avis mais on peut discuter – à une paranoïa, c’est-à-dire que ça va exclure une possibilité, je ne sais pas si elle aurait existé mais une possibilité sinthomatique. Voilà, c’est ça que je voudrais montrer. Donc, en fait, il y a deux techniques : il y a la technique qu’on verra de Klein et la technique avec ces objets réels et où donc surtout, Lefort ne joue pas, pas du tout ! Donc, elle ne mise pas du tout sur le petit autre. Ce n’est pas une rigolote ! Je vous dis ça parce que je pense que ça a des impacts pour les psychanalystes d’enfants mais aussi pour les gens qui sont amenés à soigner des psychotiques, c’est-à-dire qu’il n’est pas dit qu’il faille continuer d’insister sur le grand Autre.
Page 171, Lefort isole la fin d’une première phase – c’est elle-même qui situe les phases, donc on va suivre ses phases – marquée par le refus du biberon et la panique devant un contenant plein, Lacan dirait peut-être un grand Autre non barré. Donc, je cite Lefort :
« … après avoir tout entassé sur moi dans un état de grande agitation, il a filé, et je l’ai entendu au haut de l’escalier qu’il ne savait pas descendre tout seul, dire sur un ton pathétique – je pense que c’est important – sur une tonalité très basse qui n’était pas son genre : « maman » face au vide. Cette phase préliminaire s’est terminée ; en dehors du traitement, un soir après le coucher, debout sur son lit, avec des ciseaux en plastique il a essayé de couper son pénis devant les petites filles terrifiées. »
On repère donc que de Madame à « maman », émerge l’objet voix, ce qui n’est pas sans nous éclairer sur le glissement d’écriture chez Lacan de petit a comme autre puis comme objet petit a, ce qui est une autre façon de dire que le nouage de I, c’est-à-dire le retour à « maman » est équivalent au non-rapport RS. C’est donc autour de cette privation réelle du pénis et donc non pas autour d’une question phallique que se termine la première phase, selon Lefort. L’appel à « maman » c’est, en réalité, un appel à la métaphore paternelle. C’est en tant que cette symbolisation du manque échoue – puisqu’il est là devant le vide – que le biberon n’est pas symbolique mais réel. Lorsque le biberon tombe pendant la séance, c’est comme lorsqu’il tente de se couper le pénis. L’Imaginaire n’est pas barré, c’est-à-dire pas noué. Toute entame est une mutilation. Robert lui-même n’est qu’un objet à restituer au miroir où il frappe son reflet. Plusieurs fois, elle va dire que dès qu’il voit son image, il frappe, il frappe, il frappe.
M.-Ch. Laznik — Il frappe parce que ce n’est pas lui. C’est un petit autre.
E. Caruelle — C’est ça ! Tout à fait ! Dans une relation paranoïaque…
Robert est en-deçà de la disjonction des pulsions partielles et d’autoconservation évoquée par Freud dans Pour introduire le narcissisme. Quelle est l’idée de Rosine Lefort quand elle introduit ces objets réels dans la séance ? Cherche-t-elle une castration dans le Réel qui viendrait symboliser – φ ? Cette coupure réelle, cette mutilation au lieu d’une castration signe une Ausstossung non symbolisée par la Verneinung. Robert ne peut prélever l’objet du besoin sans décompléter l’Autre, ce qui l’empêche de boire en séance le lait puisqu’à ce moment-là il ne peut pas, ce qui nous en dit peut-être aussi beaucoup de son anorexie face à Madame. Comme il rend le pénis, il rend le biberon et le caca au grand Autre dont la décomplétude n’est pas inscrite. C’est face à la réincarnation maternelle étayée sur les objets du besoin dont Rosine est pourvoyeuse que se met en place le trou central du triskel et que va pouvoir s’élaborer le « loup », la question d’un bord, fut-il paranoïaque, et notamment donc la question de la fermeture des portes et des orifices. Une pacification donc de ce dévidage infini de Robert.
Deuxième tournant donc évoqué par Rosine, je cite :
« Ce caca, il était incapable de me le donner. Il savait dans une certaine mesure que je ne l’exigeais pas – parce que pendant tout un temps il le lui donne… enfin… il le lui donne… il le lui cède, il ne le lui donne pas – Il savait dans une certaine mesure que je ne l’exigeais pas. Il est allé le mettre à l’expéditeur, il savait bien qu’il allait être jeté [et] donc détruit. Je le lui ai expliqué. Là-dessus, il est allé chercher le pot [et] l’a remis dans la pièce, à côté de moi, [il] l’a caché avec un papier, comme pour n’être pas obligé de le donner. »
Donc, on note la formation du dedans – puisqu’il y a le dedans du pot qui va intervenir là, en même temps que la formation du caché – puisque vous voyez qu’il va ramener, à l’intérieur de la séance, ce caca-là et, en même temps, il va le cacher. Peut-on, pour autant, faire équivaloir la Bejahung freudienne et le stade du miroir lacanien ? N’allons pas trop vite dans cette équivalence imaginaire car le caché, ça n’est pas invisible et il semble que c’est sur le bord que se joue l’issue paranoïaque de la cure. C’est à partir de là, en tout cas, que Lefort repère qu’il peut être agressif au lieu de l’autodestruction dans le dévidage infini. On n’est pas dans la question du – φ mais l’agressivité a une fonction en psychanalyse. Je cite Rosine : « À partir de ce jour, il ne s’est plus cru obligé de faire caca en séance, il a employé des substituts symboliques… ». Donc, à la fin de la leçon, il va y avoir toute une discussion pour savoir si ce sont des substituts symboliques ou imaginaires. Je crois qu’ils sont imaginaires c’est-à-dire qu’ils ne vont pas être marqués par la négation… mais on va voir. En tout cas, une fois qu’il cache cet objet, c’est-à-dire qu’il pose la feuille sur le pot, va se mettre en place une série d’équivalences et donc d’objets, notamment le sable. Je cite Lefort :
« Moi-même, j’assistais en séance à de véritables tourbillons […] Ce jour-là …– oui, je pense que ce sont des équivalences imaginaires parce qu’on va voir que tous les contenus se valent. – Moi-même, j’assistais en séance à de véritables tourbillons […]. Ce jour-là, après avoir bu un peu de lait, il en a renversé par terre, puis a jeté du sable dans la cuvette d’eau, a rempli le biberon avec du sable et de l’eau, a fait pipi dans le pot […] [tente de contenir les contenus mais casse le biberon, puis remet le biberon en miettes dans le pot]. Il a emporté le pot. Une parcelle de sable est tombée par terre, déclenchant chez lui une invraisemblable panique. Il a fallu qu’il ramasse la moindre bribe de sable, comme si c’était un morceau de lui-même et il hurlait « le loup ! le loup ! » […] dans un état de tension intense qui ne céda qu’après une débâcle diarrhéique »
Donc à ce moment-là les interventions de Lefort…, elle précise que ça vise à différencier les contenus parce qu’en fait ils se valent tous. C’est dans ce sens-là que je vous le dis, c’est des équivalences imaginaires. C’est-à-dire que tout est égal à tout. Donc elle vise à différencier les contenus de son corps au point de vue affectif, elle dit donc
« Le lait est ce qu’on reçoit. Le caca est ce qu’on donne et sa valeur dépend du lait que l’on a reçu. Le pipi est agressif ».
Rosine tente de séparer le bon du mauvais, le dedans du dehors selon le modèle freudien de la Bejahung-Ausstossung donc elle tente de faire ça, vous voyez le caca c’est comme ça, le pipi c’est ça, par une spécification pulsionnelle, c’est-à-dire par une imaginarisation des objets a. Le contenant n’a alors d’existence que par son contenu signale Rosine Lefort. Robert hurle « le loup» quand il vide le pot et doit manger avant ou après et pour le pipi il doit boire dit-elle ; le pot pour lui ne peut avoir de réalité que plein, or Lacan va beaucoup s’arrêter sur la question, il s’agit de pouvoir supporter ce pot vide. Si pour Dick se pose la question du corps vide et noir de la mère sans contenu, donc ce n’est pas sans évoquer les histoires de forteresse vide de Bettelheim, Robert lui pose la question des contenus sans contenant. Pour l’un comme pour l’autre l’illusion d’optique ne se produit pas, ils voient… – je cite Lacan p. 151 –
« … les choses à leur état réel tout nu, c’est-à-dire : l’intérieur du mécanisme, et un pauvre pot vide ou des fleurs esseulées, selon les cas. »
Donc mon hypothèse c’est que Dick voit le pot vide et Robert les fleurs sans pot. Selon Lacan donc cette vacuité du contenu rendu supportable est ce qui en fait un objet, je cite « proprement humain » c’est-à-dire un instrument « détaché de sa fonction » dit Lacan, moi j’aurai dit détaché de son fonctionnement, mais on peut discuter.
La permanence du contenant vide c’est, me semble-t-il, le renoncement à la plénitude de la satisfaction hallucinatoire, la question d’un objet sexuel c’est-à-dire manquant qui ouvre la dimension de l’appel étayée sur les pulsions d’autoconservation. Je cite :
« Robert progressivement introduisit un délai entre le vidage et le remplissage jusqu’au jour où il a pu revenir triomphant avec son pot vide dans son bras. Il avait visiblement gagné l’idée de la permanence de son corps. »
Cette permanence du corps vide des objets réels de la fonction, disjoint du fonctionnement, est un triomphe, remarque Rosine, qui n’est pas sans évoquer la jubilation de l’enfant face au miroir. Mais il est possible, parce qu’on est tenté de voir ça mais ce n’est pas si évident, il est possible que ce qui s’élabore ce soit moins la symbolisation que l’imaginarisation de ce qui n’est pas. Je cite Rosine
« Il m’a chargé d’un autre aspect de la mauvaise mère, celle qui part. Ce jour-là il a fait pipi sur moi dans un grand état d’agressivité mais aussi d’anxiété, cette scène n’était que le prélude d’une scène finale qui eut pour résultat de me charger définitivement de tout le mal qu’il avait subi…,
– donc là on est là [Il s’agit du dessin de l’Austossung du Loup (photo 4), c’est-à-dire de la fermeture du nœud de trèfle comme équivalent d’une Bejahung/Austossung, non redoublée par une Verneinung]
… et de projeter en moi le loup, j’avais donc ingurgité le biberon avec le sable, reçu le pipi agressif sur moi parce que je partais, j’étais donc le loup. Robert s’en sépara au cours d’une séance en m’enfermant au cabinet pendant que lui retournait dans la pièce en séance, seul, monté dans le lit vide et se mettait à gémir, il ne pouvait pas m’appeler,
– c’est là où je pense qu’il y a quelque chose qui va se jouer –,
et il fallait que je revienne puisque j’étais la personne permanente. Je suis revenue, Robert était étendu, le visage pathétique, le pouce maintenu à deux centimètres de sa bouche. »
Rosine donc incarne le loup sur un mode paranoïaque, on repère ici l’éjection de la détresse du nourrisson c’est-à-dire une Ausstossung du loup dans les cabinets, il a pu évacuer le mauvais de la Bejahung. Le surmoi primitif du loup, donc le triskel centripète, le trou du triskel centrifuge du coup ! Le surmoi primitif « le loup » s’incarne alors dans le non-moi, autrement dit il y a une solidarité topologique entre le trou central du triskel et l’extérieur du trèfle puisqu’on voit que le trou central va s’équivaloir, enfin j’ai l’impression, on pourra en discuter, avec l’extérieur du trèfle et finalement on le voit, on le sait plus que ça et ça [le trou central et l’extérieur du triskel (correspond à l’expulsion, à l’Ausstossung du Loup)], c’est quand même pas sans rapport.
La Bejahung serait donc dans cette hypothèse l’avènement paranoïaque de la jonction du triskel, liaison permise par, je cite, elle parle d’exorcisme, « liaison permise par l’exorcisme du dehors persécutif, c’est-à-dire l’exorcisme d’une négativité positivée ». Robert ne symbolise pas le manque comme le repère très bien Rosine, il ne peut pas appeler au-delà du principe de plaisir. Pour disjoindre le nœud de trèfle c’est-à-dire pour que les pulsions sexuelles se disjoignent des pulsions du moi, c’est-à-dire qu’on a une disjonction, il faut renoncer à la satisfaction hallucinatoire du désir et appeler l’objet manquant. C’est l’autoconservation qui étaye les pulsions sexuelles en tant que le bébé renonce à la satisfaction sous peine de mourir de faim, c’est dans cette expérience de répétition toujours ratée au-delà du principe de plaisir que va se mettre en place la Verneinung, mais ça je l’ai déjà dit. Ce n’est pas la mère, ce n’est pas la satisfaction perdue.
Après cette séance, là où elle devient le loup, Rosine note que Robert console les petits alors qu’auparavant il les étranglait, ce qui n’est pas sans relancer la question d’un choix d’objet narcissique. Ce choix d’objet fondé sur le transitivisme aurait-il permis une autre issue que l’issue paranoïaque, par étayage donc des pulsions sexuelles sur les pulsions d’autoconservation. Aurait-il permis une issue sinthomatique dans la cure ? C’est une question de technique que je voudrais que nous puissions discuter : s’agit-il dans une cure avec un psychotique de relancer le choix d’objet par étayage ou pouvons-nous tenter au travers de ce que Winnicott appelait la fonction réflexive un choix d’objet narcissique dans le transfert qui laisserait ouverte la possibilité d’un sinthome ?
C’est juste après cette Ausstossung du loup, j’ai bientôt fini, c’est juste après cette Ausstossung du loup dans les toilettes qu’intervient la scène ombilicale où Robert va je cite « jusqu’à ouvrir sa bouche et la refermer comme un fœtus boit le liquide amniotique ». Si Rosine note qu’au début de cette expérience qui est très impressionnante où il est dans l’eau, donc elle repère qu’au début il était excessivement agité, elle repère qu’il prend conscience « d’une certaine réalité de plaisir ». Ce contenant de la Bejahung c’est très important de noter que c’est pas le corps de l’enfant, c’est celui de la mère. Lacan aurait pu dire que c’est le corps symbolique, le trésor des signifiants. La version imaginaire ici c’est le corps de la mère. Dick aussi entre dans la station maman, non pas sur un plan œdipien mais comme contenu bon, phallique, comme Robert sous peine de n’être qu’un déchet éjecté par un triskel. C’est uniquement en étant contenu dans ce contenant comme bon que Robert peut inscrire son nom dans la scène du baptême qui va suivre juste après ; seul le bon est incorporé dans la Bejahung comme réalité psychique nous dit Freud, seul le plaisir peut faire trace inscription phallique d’un signifiant dans le grand Autre qui est aussi un petit autre c’est-à-dire une mère phallique et non pas une madame pénienne. Je crois que c’est Platon dans La République qui disait que le mal ça n’existait pas ce qui me semble très freudien puisque seul le bon, seul le principe de plaisir peut faire exister le nom de Robert. Voilà.
P.-Ch. Cathelineau — On peut allumer.
C’est dense.
M.-Ch. Laznik — Moi, je veux bien discuter.
P.-Ch. Cathelineau — Vas-y !
M.-Ch. Laznik — D’abord vous remercier parce que vous avez fait un énorme travail, deuxièmement vous remercier pour une autre raison mais moi je voudrais qu’on mette le début de ce petit papier, oui d’accord, vous remercier parce que vous avez fait un travail de re-étayage avec la théorie de nœuds qui vont peut-être nous désempêtrer de ce texte. Moi je n’ai eu accès à ce texte qu’au début des années 1970, en 1953 je ne travaillais pas la psychanalyse et j’ai eu le même malaise que vous, 74-75, c’est-à-dire quoi il y a soixante ans de ça ! Déjà il y a trente ans on n’était pas en train de se prendre des douches de biberon et de pipi… et aujourd’hui vous m’avez donné la clé que je n’avais pas, je me disais en quoi c’est faux ce truc, en quoi elle se méprend, même si elle l’aide.
Aujourd’hui vous avez donné la clé. C’est parce qu’elle se base sur la théorie de l’étayage. C’est vrai que Freud qui est venu bien avant Lacan nous a laissé sur cette fausse piste de la théorie de l’étayage. La théorie de l’étayage comme vous savez c’est que le bébé satisfasse son besoin, il faut qu’il tète, qu’il mange et un jour il découvre que derrière ce sein il y a un autre dont il va pouvoir tomber amoureux, rentrer en relation pulsionnelle. Jusque-là c’est l’étayage de la satisfaction du besoin qui mène à tout. Or c’est vrai que dans les années 70 on savait déjà un certain nombre de choses, qu’ensuite Lacan nous a donné des outils, en particulier avec la théorie de la pulsion invocante et même avec les théories de la pulsion telles qu’il les élabore dans le séminaire XI. D’emblée un nourrisson est en même temps un être de relation qui s’interroge sur le désir qu’il suscite chez son autre, même avant la montée de lait, c’est typique avant la première, quand il n’y a encore que du colostrum, le bébé s’arrête et s’intéresse à voir ce qui dans la voix de sa mère le met en place d’être l’objet qui satisfait son désir à elle, il n’y a pas « j’ai tété, j’ai tété, et un jour je me suis réveillé » qui est la théorie de l’étayage. Elle est fausse, elle est à revoir. Quand tout à l’heure je vous ai demandé c’était à propos de la notion d’autoérotisme, parce que la question est de savoir s’il y a un auto érotisme inné ou pas ? Lacan ne l’a jamais critiqué clairement cette notion d’autoérotisme inné mais dès la SFP, c’est-à-dire ces séminaires-là, Laplanche qui avait en charge le dictionnaire le critique et en disant qu’au fond c’est l’apport lacanien qui le fait critiquer. C’est pas possible qu’il y ait un autoérotisme, d’ailleurs Eros c’est la divinité grecque, celle de la rencontre, il n’est pas possible d’imaginer un truc, un autoérotisme inné. Je n’ai pas le temps de développer là à quoi ça sert à Freud, ça sert très particulièrement à quelque chose mais on n’a pas le temps de le développer. En tout cas je vous remercie beaucoup de m’avoir fait comprendre pourquoi cette base sur la théorie de l’étayage, parce que cette soupe de pipi, de lait m’énervait tellement dans les années 70 que je n’arrivais pas à réfléchir comme vous avez réfléchi et je dois vous dire que je n’avais pas du tout les outils de la théorie des nœuds donc je ne peux que vous remercier. Par ailleurs je pense, je ne sais pas si c’est venu à Pierre-Christophe en écoutant, mais comme Pierre- Christophe se demande tout le temps quand il travaille avec nous, comment on pourrait penser comment dans une erreur qui a eu lieu dans la tresse, comment seraient les guérisons, ou les rattrapages ? Je me suis dit qu’il faudrait peut-être qu’on travaille cette histoire du triskel, ça serait intéressant de mettre en parallèle le triskel et la tresse et donc c’est une piste ouverte, je vous inviterais peut-être à notre séminaire fermé un soir pour qu’on travaille ce petit point-là parce que les choses il faut les… Moi quand vous me montrez tout ça, je dois dire que je suis un peu noyée du haut de mon grand âge parce qu’il y a beaucoup trop de choses donc je n’en attrape que des petits bouts qui me paraissent m’aider, qui sont très riches.
L’autre chose très riche que vous faites c’est votre RS ensemble et le I dehors, moi ça me gêne pas du tout quand vous dites que pour Dick cela serait comme si c’était l’investissement phallique narcissique qu’on figurerait par les fleurs et chez lui c’est le corps éclaté qu’on figurerait par le pot et chez chacun c’est ce qui manque au niveau de la constitution du schéma optique, cela ne me gêne pas du tout. Mais la non-constitution du schéma optique qui vous permet d’écrire à juste titre R et S ensemble et le I qui fout le camp, c’est ce que Lacan nous a…, là on a un nœud qui n’est pas borroméen parce qu’une des consistances fout le camp. Le seul reproche que je vous ferai c’est, dans votre audace très moderne, de rester ringarde par rapport au concept de psychose. Je sais que la psychiatrie allemande et la psychiatrie française ne connaissaient que psychose, névrose et perversion mais depuis qu’on a ces outils-là on peut être beaucoup plus riche. On pourrait dire : c’est une clinique du ratage de l’Imaginaire à se nouer aux deux autres. Moi je pense que c’est pas ça les psychoses que vous voyez chez les adultes à Sainte Anne, c’est pas ça leurs histoires de bébé, ils ont eu un autre démarrage. Voilà, je crois que ça se sont des formes de ce qu’on appellerait les autismes très largement et pour appeler les autismes si on est lacanien on dirait c’est quand R et S sont ensemble et que ce I fout le camp. Que c’est défensif je vous suis tout à fait.
Il y a un autre aspect très intéressant que vous avez souligné c’est sur la douleur et la souffrance, parce que je pense que quand on prend la tresse et Pierre-Christophe nous avait cassé les pieds pour qu’on prenne en compte quand c’était, si le Réel était au-dessus du Symbolique ou en-dessous il fallait sûrement prendre ça en compte, tu te rappelles Pierre- Christophe ? Eh bien je crois que dans le premier temps que je vous ai dit l’autre jour pour moi c’est l’Esquisse, à plusieurs reprises vous faites allusion à des choses qui ont à voir avec l’Esquisse, vous l’avez remarqué, quand vous dites qu’il faut que tout l’investissement ne soit pas au pôle hallucinatoire, il faut en renvoyer…, etc. on est dans l’Esquisse là, c’est très important. Eh bien, je pense que cette souffrance ne permet pas le premier temps du tressage. Du coup, pour des raisons défensives le deuxième temps qui serait là où l’Imaginaire doit se mettre par-dessus le Réel c’est-à-dire que le schéma optique qui se met en place, ça rate aussi, donc on est dans des cliniques semblables, je pense qu’on a pas besoin d’utiliser le mot psychose, ça fait ringard si vous me le permettez et ante-lacanien [— Je suis d’accord]. Je pense que Lacan nous donne des outils plus riches que ça et surtout vous les maniez très bien.
Alors il y a un autre petit mot où j’aurai une toute petite critique c’est quand vous utilisez « paranoïaque » parce que paranoïaque pour moi renvoie à Schreber si vous voulez, c’est un grand monsieur, là je pense pas que ce gosse soit devenu quoi que ce soit capable de… mais on peut reprendre le terme de Mélanie Klein que Lacan aimait bien qui était sa position « schizo-paranoïde » c’est-à-dire ces espèces d’expulsions très violentes où l’autre devient très dangereux et persécutoire, c’est ce qu’elle appelle schizo-paranoïde, il y a parano dedans, les deux, juste pour qu’on ne s’embrouille pas avec la clinique, le grand danger c’est des confusions avec la clinique des psychoses adulte, je sais pas si vous seriez d’accord avec moi ? Mais merci beaucoup, parce que moi j’ai toujours trouvé ce texte un cauchemar, ça me mettait dans une colère noire contre cette dame ; ils ont beaucoup changé les Lefort, ils ont écrit des choses beaucoup plus intéressantes et en particulier le dernier livre qu’ils ont fait sur l’autisme(4) dont je ne me rappelle plus du tout le nom qui était uniquement sur les génies, les autismes comme les grands écrivains, etc. et plein de livres qui étaient passés très inaperçus et c’est sur le ratage de la constitution du grand Autre, c’est aussi au Seuil et je vous le dirais pour la prochaine fois, ils ont quand même fait beaucoup de chemin mais c’est vrai que c’est cette théorie de l’étayage qui l’embrouille complètement.
Hubert Ricard — Mais le petit Robert il est génial quand même !
M.-Ch. Laznik — Mais Dick aussi !
H. Ricard — Il l’est plus même que Schreber, moi je trouve, mais enfin bon je ne vais pas discuter ça.
M.-Ch. Laznik — Mais je ne pense pas qu’il soit devenu quelqu’un de très bien adulte.
H. Ricard — Lacan dit, a l’air de dire qu’il sera schizophrène quand même. Vous avez l’énoncé à la fin du texte.
M.-Ch. Laznik — Je ne crois pas. Malheureusement je crains, mais Lacan n’avait pas eu les cliniques qu’on a eues plus tard. [H. Ricard — Tout à fait, mais je vous l’indique quand même.] Je crois qu’il n’en est pas arrivé à une chose aussi géniale que schizophrène. Je crains surtout, vous savez qu’elle est partie, elle l’a laissé, vous savez qu’elle était partie en voyage, que son traitement a été arrêté là, tandis que Mélanie Klein, pour petit Dick, elle l’a suivi, elle est partie, elle l’a suivi, elle est revenue, elle l’a suivi, des années et des années… Et là, je crains qu’il ne soit devenu beaucoup plus déficitaire que ça ! Beaucoup plus dans un champ déficitaire… Malheureusement, les Lefort ne sont plus de ce monde pour qu’on leur pose la question, je ne sais pas s’ils ont des élèves qui pourraient nous répondre ? Je crois que malheureusement…, je crains des choses plus abîmées que ça.
P.-Ch. Cathelineau — J’ai une question qui concerne le choix de penser cette structure au départ à partir du triskel centrifuge et…
M.-Ch. Laznik — Tu parles un tout petit peu plus fort !
P.-Ch. Cathelineau — Le choix de penser au départ cette structure à partir du triskel centrifuge comme éclatant en quelque sorte…
M.-Ch. Laznik — Ç’est intéressant comme idée.
P.-Ch. Cathelineau — Ç’est très intéressant, mais ma difficulté…
H. Ricard — Mais ça vient d’où cette idée ?
P.-Ch. Cathelineau — Attendez ! Attendez ! Vous permettez, deux minutes ! Choix de penser le triskel centrifuge qui est donc une façon de penser assez, assez performative de décrire le début de la cure, où on a effectivement cette description que vous donnez, que donne Rosine, d’un éclatement dans l’extériorité du champ pulsionnel…
M.-Ch. Laznik — Ah ! Ce n’est pas sûr que ce soit le champ pulsionnel.
P.-Ch. Cathelineau — C’est ça la question.
E. Caruelle — C’est en deçà de la pulsion.
P.-Ch. Cathelineau — En deçà de la pulsion mais en tout cas, un éclatement dans l’extériorité.
M.-Ch. Laznik — Si la pulsion lacanienne, c’est ce qui se joue sur les trois temps…
P.-Ch. Cathelineau — Non mais attends, il y a quelque chose qui quand même me pose question du point de vue de la topologie simplement, de la logique topologique, c’est comment vous faites le lien entre ce triskel centrifuge et puis la réintroduction que vous faites au cours de la démonstration à partir d’autres temps logiques que vous repérez dans le traitement de Robert, de consistances qui sont liées de telle sorte qu’on puisse les repérer, soit on les repère en tant que forcloses, soit on les repère en tant que nouées de façon olympique, là j’ai du mal à vous suivre… ce que j’ai du mal à penser d’un point de vue strictement mathématique…
M.-Ch. Laznik — Tu veux dire le bas de son dessin ? [E. Caruelle — Non, le haut.]
P.-Ch. Cathelineau — Ce que j’ai du mal à suivre, c’est la transition logique entre un triskel centrifuge et un nouage olympique entre R et S avec la séparation de I et on voit bien la question que tu poses sur la question de la tresse, elle est là, c’est-à-dire soit on a affaire à une tresse et effectivement, il y a des ratages de la tresse qui permettent de penser que R et S sont noués de façon olympique et I s’en est détaché, soit on a affaire à autre chose que quelque chose de la tresse, plus originaire et qui est de l’ordre du loup centrifuge, on va dire, de l’éclatement, ou alors il faut supposer, peut-être que c’est ce que vous voulez dire, que dans le temps du traitement de Robert, il y a des sauts qui font qu’on passe d’une structure en forme de triskel à une structure en forme de tresse.
E. Caruelle — Oui c’est ça que j’ai dit ? Non… Alors, je n’ai pas bien dit !
P.-Ch. Cathelineau — Donc ça veut dire qu’il y a des sauts qui sont des sauts assez inexplicables.
E. Caruelle — Ah non ! Ils ne sont pas inexplicables ou je me suis mal expliquée alors ! C’est de ma faute mais ils ne sont pas inexplicables mais justement, pour le coup je suis assez d’accord pour laisser tomber le mot de psychose parce que, à part avoir une conception fixiste et faire des constats, c’est vrai, surtout dans la psychanalyse d’enfant, mais j’espère que ça se passe quand même dans la psychanalyse d’adulte, il y a quand même des mouvements qui se produisent. [P.-Ch. Cathelineau — Il y a des mouvements oui] Voilà. Et donc il me semble que par exemple la présence, c’est pour ça que j’étais repartie du sentiment vécu de la présence de l’analyste ou de Rosine, ça modifie considérablement l’état de l’enfant qui pour le coup repart sur quelque chose qui, à mon avis, est très originaire chez un bébé, comme vous le disiez, c’est-à-dire au départ ce n’est pas la pulsion, on ne sait pas ce que c’est, c’est une éjection comme ça, vous disiez ça fait des mitraillettes, un bébé. C’est vrai quand on voit un bébé, ça explose dans tous les sens mais c’est quand même déjà d’emblée un bébé qui est à la recherche, c’est-à-dire que l’Hilflosigkeit de Freud, etc., ce n’est pas un bébé lion ou un bébé chat, c’est d’emblée un bébé qui est dans une structure humaine, et pour ma part, la structure humaine, c’est au moins le triskel.
P.-Ch. Cathelineau — Non mais ce que je veux dire c’est que dans le cours de votre démonstration, vous avez des allers et retours d’une structure qui est une structure olympique à une structure en triskel, vous partez du triskel, vous passez à la structure olympique, et vous revenez au triskel donc il y a des allers et retours qui me paraissent…
E. Caruelle — … et j’explique.
H. Ricard — C’est dans le texte !
P.-Ch. Cathelineau — Je ne dis pas que ce n’est pas dans le texte.
E. Caruelle — Non, je l’explique, il n’y a pas de problèmes. Je me suis mal prononcée.
P.-Ch. Cathelineau — Je voudrais une explication et sur le plan strictement topologique, je m’interroge, je ne sais pas, s’il est possible de penser des transformations parce que c’est ça, ce que vous êtes en train de montrer, c’est très intéressant, c’est que le psychanalyste, en l’occurrence travaille à transformer la structure et il la transforme par des sauts, des sauts logiques, on va dire, ou topologiques qui font qu’il part d’un triskel centrifuge, il arrive à une structure qui est une structure olympique et il revient à un triskel fermé. C’est comme ça que je l’ai entendu…
E. Caruelle — Alors ! C’est peut-être que j’ai mal expliqué, c’est que même la structure olympique, pour ma part, et d’ailleurs c’est intéressant parce que Lacan ne le reprend pas du tout. Alors je ne sais pas si dans le texte, je l’avais lu il y a longtemps, mais le grand livre là, si elle analyse ou pas ce mot de « madame » ? Mais Lacan laisse complètement tomber, il va parler du loup, or il y a quand même deux mots et que du coup quand même, le fait qu’il y ait une nomination du Réel, par le loup… donc c’est pour ça que je dis en réalité, c’est-à-dire que ça va nommer tout le réel, tout Réel est le loup, n’importe quel réel, donc il n’y a pas de petit autre, il n’y a pas de spécificité d’un tel ou un tel, et donc rien que le fait qu’il y ait une consistance, on va dire symbolique, qui nomme une consistance du réel, c’est quand même la trace que même dans un nœud olympique, en fait il n’y a pas de nœud à deux parce que sinon ce serait une mise en continuité, ce serait la manie, et puis probablement la mort, c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas justement ce couple. Du coup, le côté olympique, en fait il est déjà illusoire, on a besoin de le…, mais en fait il y a d’emblée madame qui est au moins autant l’éjection de I que son retour, c’est-à-dire que en fait ça c’est déjà la trace que I, s’il est forclos, il fait aussi retour parce que sinon il y aurait carrément une mise en continuité, et donc il n’y aurait pas de nomination, il n’y aurait pas de consistance symbolique, il n’y aurait rien, il mourrait probablement. Donc, même la consistance olympique, elle est quand même à trois, c’est-à-dire qu’on ne sort pas du trois. C’est-à-dire que le simple fait qui ait couple, fait qu’il y a déjà I, qui on va dire, je ne sais pas comment il faudrait dire, qu’il y a une espèce de mise en écho, en tension des deux : de RS et de I quand même, c’est-à-dire du loup et de madame qui finalement sont équivalents.
Thatyana Pitavy — Ça pose un problème du fait que dans le dessin, tu les mets à part c’est-à-dire que la structure, elle est du triskel, elle est à trois, on ne peut plus passer à cette dimension effectivement olympique. La question, c’est la question de la structure de la forme qui là se mêle tout le temps autour…, c’est-à-dire qu’effectivement à partir du triskel, on peut trouver des formes, de trèfle, des formes borroméennes généralisées, il donne des points de…, je veux dire qui donne des points dans la cure tout à fait différents..
E. Caruelle — Oui il est gênant ce temps ! On est d’accord.
Th. Pitavy — Il est gênant parce que cette idée qu’on fait sauter un rond, on n’est plus dans cette direction du départ que c’est à trois…
E. Caruelle — Si ! C’est ça que je n’arrive pas bien à expliquer. Ce n’est pas comme si quand même il n’y avait pas I. Il est quand même dessiné. Je ne suppose pas qu’il n’est pas là.
Th. Pitavy — Oui, mais là ce n’est pas une structure borroméenne… [E. Caruelle — Non, mais enfin] … alors que le triskel, il est déjà à trois.
E. Caruelle — On est d’accord [H. Ricard — … oui, mais il n’est pas borroméen du tout.]
M.-Ch. Laznik — Est-ce que le triskel à trois, quand ça explose comme ça… [E. Caruelle — Si ça explose trop…] … est-ce qu’on peut même parler de structure ou est-ce que ce n’est pas un truc qui est en mise en échec de la structure ?
E. Caruelle — Non ! C’est le démarrage [Th. Pitavy — C’est le départ] Je pense que c’est une tension vers la structure mais s’il n’y a pas de principe de plaisir, c’est-à-dire que si la tension d’un point de vue économique, c’est pour ça que je pense qu’il y a un point de vue économique chez… alors que Freud, tu vois quand…
Th. Pitavy — Pourquoi économique ? C’est le point de réel chez Lacan.
E. Caruelle — Oui exactement ! Mais imaginons si ça mitraille un peu trop, il est possible que quelqu’un forclose, je ne sais pas si on peut dire ça mais, la question même du corps pour se défendre. Ça ne veut pas dire qu’elle n’est pas là. Elle est là. Forclos, c’est ce que j’avais essayé de défendre, c’est-à-dire que [M.-Ch. Laznik — Elle a complètement raison.] Éjecté, c’est pas rien.
M.-Ch. Laznik — S’il y a une trop grande douleur, si le principe de plaisir est trop mis à mal, il y a une telle excitation que la constitution du corps en tant que tel où l’Imaginaire joue un rôle très important, n’arrive pas à se mettre en place.
Th. Pitavy — C’est là notre désaccord. Il est là. Peut-être faut-il trouver un autre dessin ?
E. Caruelle — C’est ça. Peut-être le dessin n’est pas bon ? Mais parce que, je suis d’accord avec toi que… [Th. Pitavy — La consistance, elle est là, même si…] elle est là. C’est-à-dire que ce qui est forclos fait retour, donc il n’y a pas de forclusion on va dire sans retour. Il est là quand même, sinon il mourrait.
M.-Ch. Laznik — Elle est là mais est-ce qu’elle va s’articuler ?
E. Caruelle — Sinon il mourrait. [Th. Pitavy — Elle n’est pas nommée] On va dire que ça là, (cf. « I » : la forclusion de I c’est aussi son retour, nous sommes tous sous le coup d’un autotisme du trois, le trois est premier, il n’y a pas de nœud à deux) ça c’est aussi vrai que ça se détache, que ça se retend vers ça. C’est la même chose en fait. [M.-Ch. Laznik — Ça ne peut ne pas se nouer] Oui, peut-être que le dessin n’est pas bon. Il faudrait trouver un autre dessin. À chaque fois, tu me dis ça.
Thierry Roth — Comment tu décrirais Elsa ce retour où ça se retend, comment tu pourrais dessiner le I ?
E. Caruelle — Alors attends, soit il va y avoir le retour, c’est après la présence de Rosine, ça a redéclenché, donc soit elle va faire un choix d’objet qui va au mieux faire une Behajung, c’est-à-dire avec la consistance de I qui est là puisqu’on retrouve le triskel, soit, c’est quand mon espoir, je pense que quand même dans la cure, la présence de I qui n’est pas noué là, c’est-à-dire si un analyste au lieu de forcer sur le grand Autre et donc sur la question de la relance des pulsions sexuelles, si on prenait en compte la question de la psychose, et donc que on jouait la question du petit autre pour ma part ou en tout cas au moins la question réflexive, puisque petit autre c’est beaucoup dire, il faudrait que ce soit noué et là, ce n’est pas noué mais disons que c’est peut-être pour cela qu’on joue avec les enfants et peut-être devrait-on jouer plus avec les adultes parce que si on met I ici, la présence même de I, normalement c’est équivalent au non rapport RS, or eux ils sont enchainés, donc ça va poser un problème mais on peut supposer, c’est ce qu’on a vu à Saint-Anne, que le fait que l’analyste impose I puisse susciter éventuellement un sinthome [M.-Ch. Laznik — Bien sûr ! C’est ce qu’on connait pour beaucoup de petits enfants autistes] Exactement ! Normalement la présence de I ça devrait, même si on ne peut pas, disjoindre R et S. C’est équivalent normalement. [M.-Ch. Laznik — Ça peut permettre en tout cas] Ça peut permettre un sinthome. Ça veut dire qu’on pourrait éviter à nos patients de, de…
M.-Ch. Laznik — Je voudrais juste quand même, parce que là ce n’est pas possible… je suis d’accord avec vous, c’est juste au niveau de la nomination. Elle n’a pas joué sur les pulsions et elle n’a pas joué sur le sexuel. Elle a joué sur cette fameuse histoire du… [Elsa Caruelle — c’est ça ! Mais elle a parié qu’elle pouvait étayer les pulsions sexuelles.] … les pulsions, c’est savoir comment je peux devenir l’objet merveilleux de ma « maman » ou de ma « madame », ou de mon analyste, comment elle peut me trouver délicieux à croquer… pour de semblant !
E. Caruelle — Je pense que c’est beaucoup plus ça qui se joue en tout cas pour ma part quand je suis avec des enfants, y compris autistes et que ça marche, souvent on n’est pas dans un truc très intelligent, quoique des fois ça arrive…, on est plutôt dans un truc où moi-même je ressens beaucoup de plaisir et l’autre aussi. Il y a presque une fonction réflexive… [M.-Ch. Laznik — Et le bébé peut ressentir votre plaisir. C’est ça le sexuel, c’est ça les pulsions sexuelles.] Il y aurait un sexuel possible et du coup, si on fait un sinthome, le nœud est quasiment sexuel, on va dire.
M.-Ch. Laznik — On peut dire très clairement qu’au séminaire XI Lacan dit que la faim et la soif, ça n’a rien à voir avec la pulsion. C’est la première chose de sa critique au texte de 1915 de Freud. Il dit que ça n’a rien à voir avec la suite. La faim et la soif, le boire et le manger, ça il va le jeter dans le champ des pulsions d’autoconservation. Il ne dit plus ça, il dit dans le champ narcissique de l’amour. Les pulsions sont toutes sexuelles, elles n’ont plus rien à voir avec l’autoconservation. Du lait dans un biberon, ça n’amène pas de sexuel. Ça amène de l’étayage.
H. Ricard — Et où vous situez le « maman » qui arrive au milieu du texte ?
E. Caruelle — Je ne sais pas. Je pense quand même qu’à ce moment-là, une maman, un bébé sans sa mère, ça n’existe pas, on va dire donc…
H. Ricard — Il ne l’avait jamais prononcé.
E. Caruelle — Il ne l’a jamais dit ; il disait madame. Donc au moins, on peut supposer un nouage minimal qui est qu’on repart sur une base, on va dire qui est presque originaire.
H. Ricard — Mais ce n’est pas le retour au triskel.
E. Caruelle — Si ! Je pense que c’est ça. C’est-à-dire qu’elle au départ quand elle le prend, c’est pour ça que je l’ai mis en deuxième, quand elle le prend, il est là déjà lui (Quand elle le rencontre, il a déjà ejecté I dans le réel). Il est déjà là mais on peut supposer qu’il y a eu un premier temps (Triskel originaire), et qu’en fait, ce qu’elle fait c’est que dès qu’elle est présente, ça relance la question très vite, très vite il va se mettre à dire « maman », très vite. Mais qu’au départ, quand elle le prend, lui, il a déjà éjecté I depuis un bon moment, puisqu’il s’est retrouvé avec une sonde, etc.
M.-Ch. Laznik — Il en a bavé, c’est effroyable ce petit garçon.
Martine Bercovici — Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire par l’Ausstossung du loup parce que je pense que le lapsus est d’ailleurs révélateur, ce loup il est à la fois centripète et centrifuge et qui tient toute la structure non symbolisée et qu’il est au bord de toutes les équivalences qu’il n’arrive pas à faire. D’ailleurs, Lacan le dit, c’est le trognon du langage. C’est avec ça et ce madame qu’il est en communication avec l’extérieur. [E. Caruelle — On est d’accord.] Effectivement ce que ne fait pas Rosine Lefort, c’est de jouer là-dessus et de chercher les équivalences symboliques comme le ferait Mélanie Klein. À mon avis son travail, et c’est ce qui est gênant pour moi, c’est qu’il est entièrement centré sur l’abréaction, et rien d’autre.
E. Caruelle — Non, non ! Parce qu’elle est beaucoup dans le texte Remémoration, etc… c’est-à-dire elle va resymboliser.
M. Bercovici — Oui abréaction, c’est ça. Elle est le support de l’abréaction du petit qui, en fait, fait le travail tout seul.
E. Caruelle — Moi, je ne sais pas. Je pense… cela dit je suis d’accord avec vous, c’est pour ça que le loup je l’ai mis à tous les niveaux, je ne l’ai pas mis que là.
M. Bercovici — Il est à la fois centripète et centrifuge. Qu’est-ce que vous voulez dire exactement par cette Ausstossung ?
E. Caruelle — Je veux dire que le centre du triskel c’est-à-dire le trou central, donc au départ c’est le loup centrifuge, c’est tout à fait équivalent ensuite à l’extérieur du triskel. D’ailleurs ce qui est vrai, on le sait plus facilement dans les nœuds borroméens, le centre du triskel par exemple, il est plein ou il est vide en fonction aussi de l’extérieur du triskel, donc il y a des équivalences topologiques entre le centre du triskel et l’extérieur puisqu’en fonction, il est plein ou il est vide, je ne sais pas comment dire ça… Enfin bon !
H. Ricard — Merci ! Continuez comme ça, c’est bien (à mi-voix, en s’en allant)
(Brouhaha… on rallume la lumière)
En aparté :
E. Caruelle (s’adressant à P.-Ch. Cathelineau en aparté) — Je n’ai peut-être pas bien répondu… je pense qu’il a posé la question du sentiment vécu de la présence, qui change… c’est-à-dire avec ou sans I…
P.-Ch. Cathelineau — Je n’en sais rien. En tout cas c’est intéressant.
E. Caruelle — Je ne pense pas qu’il y ait des sauts, voyez, que ça, ça soit éjecté, ça va aussi curieusement entraîner une fermeture [P.-Ch. C. — Oui.] C’est-à-dire que I reste là quand même, si c’est fermé ces consistances.
P.-Ch. Cathelineau — Mais enfin ça pose un problème… ça pose un problème logique.
E. Caruelle — Ah bon ! Moi je ne le vois pas… D’accord.
P.-Ch. Cathelineau — Le passage du triskel au nouage olympique… (Brouhaha)
M. Darmon — Ça suppose des fermetures…
E. Caruelle — Non mais la fermeture, c’est-à-dire, là, si I est éjecté, la fermeture c’est simplement la survivance on va dire de I, y compris dans la structure olympique, c’est-à-dire qu’il y a quand même une consistance, c’est-à-dire que le loup, ce n’est pas seulement des lettres, c’est vraiment une consistance, donc ça veut dire que même dans le nouage olympique, dans la fermeture donc, du truc quoi, c’est-à-dire une forclusion, ce n’est pas rien, ce n’est pas équivalent, qui n’est pas I. Il est là quand même, même forclos. Ça pourrait passer non ?
P.-Ch. Cathelineau — Si, si !
E. Caruelle — Ça ne vous irait pas ?
P.-Ch. Cathelineau — Je ne sais pas.
M. Darmon — En tout cas merci de lire les Écrits techniques à la lumière de la topologie.
P.-Ch. Cathelineau — Ça donne à penser. C’était très bien, excellent.
Brigitte Le Pivert — Et ça dénote peut-être du travail qui se produit dans la relation !
P.-Ch. Cathelineau — Certainement.
Transcription : Marie-Pierre Bossy, Marie Combet, Mireille Lacanal-Carlier, Paul Claveirole.
Relecture : Monique de Lagontrie
(1) Cf. Freud, « Remémoration, répétition et perlaboration », in La technique psychanalytique.
(2) Freud, « Le problème économique du masochisme », 1924 traduit par J. Laplanche, Dépôt légal – Ire édition : 1973 ; 13e édition : 2010, in Névrose, psychose et perversion.
Marguerite Duras compose, avec Savannah Bay, une pièce sur la mémoire qui semble aussi être une ode à la comédienne qu’est Madeleine Renaud, et avec laquelle elle a travaillé à plusieurs reprises. Une dédicace précède le texte publié aux Editions de Minuit : « (…) Tu es la comédienne de théâtre, la splendeur de l’âge du monde, son accomplissement, l’immensité de sa dernière délivrance. Tu as tout oublié, sauf Savannah, Savannah Bay. Savannah Bay, c’est toi ».
(4) Robert et Rosine Lefort, Marie-Françoise ou l’autisme, Naissance de l’Autre, Le Seuil, Paris, 1980.
– Robert et Rosine Lefort, La Distinction de l’autisme, Champ Freudien, 2003.