
Lire les textes d’Ibn Rushd, en arabe, en anglais ou en français, m’a
paru une tâche particulièrement difficile. Lire et parcourir les
commentaires de la logique d’Aristote (l’Organon) par Ibn Rushd est une
tâche d’une gymnastique mentale inhumaine pour quelqu’un qui n’y est pas
exercé. Le caractère aride des textes, réduits parfois
à une suite d’énoncés auxquels sont substitués des
lettres provoquait, chez moi, un sentiment de malaise diffus.
La polémique du livre » Tahafot-at-Tahafot « , au contraire,
créait une animation qui, malgré la difficulté conceptuelle,
me réveillait et me permettait de continuer. Cette polémique qui
avait pour but de battre en brèche les attaques de Al-Ghazali contre
les philosophes me permettait enfin d’entrevoir plus clairement qui était
Ibn Rushd qui, ici, sort de sa réserve et défend son morceau.
Ici, il y avait un dire. Il y avait de quoi travailler pour savoir ce qui le
menait, ce qu’il cherchait, quel était son but. Il ne s’agit pas de dire
que dans ses commentaires de la logique d’Aristote Ibn Rushd se cachait derrière
un travail d’exégète car il est évident que sa manière
de manipuler les textes de son maître permettait de voir son ambition
de se servir du frayage d’Aristote pour le pousser plus loin. Son intuition
de la nécessité de propositions ternaires dans son commentaire
sur » l’interprétation » en témoigne. Nous savons combien
ceci a intéressé Lacan dans ce qu’il a fait du travail de Peirce
et de son quadrant.
Je ne m’étendrais pas ici sur la diversité faramineuse des sujets
traités dans les livres d’Averroès qui permettent tout de même
de sortir de la difficulté que j’évoque ici.
Quelle était la quête d’Ibn Rushd ? Il me semble que cette quête
s’inscrit dans la suite de la quête de ses prédécesseurs
Miskawayh, Al-Farabi, Ibn-Baja, Ibn-Sina, et bien d’autres qui, chacun à
sa façon, cherchait la félicité, le bonheur, dans une certaine
harmonie, un certain accord. Harmonie entre deux maîtres (Platon
et Aristote), entre foi et raison (c’était le rêve du grand-père
d’Ibn Rushd) harmonie entre les religions, etc. La recherche en somme de ce
qui peut nous être commun, d’un terrain commun. Les propositions binaires
contraires ou contradictoires, les copules, pour lesquels Averroès forge
un mot en arabe ( » sour « ). Ça résonne bien en
français, sourd. Lacan nous a appris à écrire le mot raison
: r.é.s.o.n, comme ce qui résonne. » Sour « en
arabe, c’est le mur, la muraille, ce qui barre, ce qui fait barrage.
Passons. Pour aborder cette oeuvre monumentale d’Ibn Rushd, je me proposais
de traiter la question du savoir. Très rapidement le savoir m’amenait
vers la question de l’amour car il est patent que l’amour est lié au
savoir. Pour nous, analystes, le transfert nous le montre : celui à qui
je suppose le savoir, je l’aime.
Donc, pourquoi ne pas parler d’amour à propos d’Ibn Rushd, d’autant
plus que d’âme, il ne parle que de cela et que l’accent, en français,
circonflexe à l’occasion, sur le a et qui me vient de Lacan, permet
d’y entendre l’équivoque à propos de l’âme et de l’amour.
Dans le Littré, je suis tombée sur l’adjectif » âmé
« qui veut dire aimé. » Le fils âmé « .
Du même coup pour moi, arabophone, le mot » nafs « qui
est la traduction d’âme veut aussi dire l’esprit, la respiration, pneuma,
mais qui indique aussi l’identique, le » même » et pourquoi
pas le » m’âme « . J’aurais pu aussi bien proposer de
parler de » m’âmour « si je l’osais. Nous voilà
pas très loin de la question de la vérité dont les philosophes
sont si friands, nous aussi d’ailleurs. Mais voilà que si la vérité
ne peut être que mi-dite et du même coup mi-métique, nous
retrouvons ainsi la catégorie de l’imaginaire que Lacan nous indique.
Au programme de notre colloque, mon intervention a été classée
dans la rubrique de » l’Amour de Dieu « . Evidemment, dès que
nous cherchons à parler d’amour entre l’homme et une femme, un troisième,
Dieu, vient s’interposer. C’est divin. En arabe, comme tout le monde le sait,
Dieu se dit Allah. D’où vient ce terme ? Certains théologiens
interdisent d’extraire la racine du Nom, d’autres tentent des explications.
La racine du nom serait le verbe trilitère WLH (walaha) qui veut dire
aimer à la folie, aimer passionément, » walah «
c’est la folie amoureuse. » Alaha » veut dire être perplexe
comme » tahayara « , le même terme indiqué dans
le titre du livre de Ibn Maymoun (Maïmonide) (Dalahat al-Haïrine)
traduit par Le Guide des Égarés. On pourrait aussi bien
le traduire par » Le guide des amoureux « . C’est aussi la demande,
la supplication de l’enfant à sa mère.
Prenons aussi le verbe être en arabe. WJD qui n’est pas sans poser de
problème et se dérober à son usage. Celui qu’Ibn Rushd
utilise c’est » woujoud « , » mawjoud « , de
la racine » wajada « , trouver, se trouver, » wajd «
c’est aussi l’amour, le manque, mais aussi le manque à être. Lacan
évoque la difficulté de l’usage de ce signifiant dont il montre
l’équivoque avec maître (m’être) et l’Éternel.
Nous voilà de retour à Ibn Rushd et son maître Aristote
que Lacan nous apprend à lire. Lacan, dont le nom n’a pu être cité
dans l’intitulé de notre colloque, nous dit ceci, c’est que pour les
lire, peut-être les lirions-nous mieux à mesure que ce savoir,
nous le leur supposerons moins, c’est-à-dire que nous les aimons moins.
En philosophie, Dieu a dominé le débat de l’amour. Ibn Rushd
ne cache pas son agacement, dans son commentaire de » la Poëtique
« , par rapport à ce qu’il appelle » la poésie des arabes
« , entendons les arabes avant l’Islam. La période d’avant l’Islam
s’appelle » la période de l’ignorance « , » Al-Jahiliyya
« . Les poèmes de cette période commencent obligatoirement
par quelques versets d’amour, évoquant les restes, les traces, dans le
désert, du passage, de la présence de la bien-aimée nomade,
partie. Pour Ibn Rushd, fidèle à l’éthique aristotélicienne,
cette poésie ne pouvait déboucher sur le Bien recherché,
le poète y chercherait le semblant et s’éloignerait de la réalité.
Pour lui, ces poètes étaient inconscients des effets de leur poésie.
Nous héritons avec nos cultures monothéistes de valeurs liées
à ce souci de bonheur, du Bien et d’harmonie.
Reprenons ce que nous a laissé Platon dans le Banquet par la
bouche de Diotime : » Entre savoir et ignorance, amour est intermédiaire.
Parmi les Dieux, il n’y en a aucun qui s’emploie à philosopher, aucun
qui ait envie de devenir sage, car il l’est ; ne s’emploie pas non plus à
philosopher quiconque d’autre est sage. Mais pas davantage les ignorants ne
s’emploient de leur côté à philosopher, et ils n’ont pas
envie de devenir sages…
Quels sont donc alors, Diotime, m’écriais-je, ceux qui s’emploient
à philosopher, si ce ne sont ni les sages, ni les ignorants ?
La chose est claire, dit-elle, et même déjà pour un
enfant ! Ce sont ceux qui sont intermédiaires entre ces deux extrêmes,
et au nombre desquels doit aussi se trouver Amour. La sagesse en effet est évidemment
parmi les plus belles choses, et c’est au beau qu’Amour rapporte son amour ;
d’où il suit que forcément Amour est philosophe et étant
philosophe, qu’il est intermédiaire entre le savant et l’ignorant. «
Que nous dit Averroès sur le savoir ? Dans » Tahafot-at-Tahafot
« , chapitre sur la négation des attributs de Dieu, il dit ce
qui peut se résumer ainsi : le savoir de l’homme concernant les choses
existantes autres que lui est identique avec le savoir de son essence propre,
puisque son essence n’est rien d’autre que son savoir des choses existantes.
Car si l’homme connaît la quiddité qui le caractérise et
si sa quiddité est la connaissance des choses, alors le savoir de l’homme
de lui-même est nécessairement le savoir de toute les choses. Ceci
est clair dans le cas de l’artisan, car son essence, grâce à laquelle
il est appelé artisan, n’est rien d’autre que sa connaissance des produits
d’art.
» L’essence de l’homme est le savoir et le savoir est d’une part, la
chose sue et d’autre part, autre chose. S’il ignore un objet de la connaissance,
alors il est ignorant d’une partie de son essence. etc. «
Nous savons comment ce n’est qu’après s’être assuré
de la volonté de savoir du Calife qu’Ibn Rushd a accepté de commenter
les oeuvres d’Aristote pour les rendre plus accessibles à ceux qui
voulaient savoir. On a pu lui imputer, à tort à mon avis, de prôner
deux vérités : celle de la foi et celle de la raison. Ce qu’il
cherchait à démontrer c’est que la vérité révélée
rendait celle à laquelle accédait la rationalité plus parfaite.
Ce qui résistait à la rationalité dans la foi révélée
ne signifiait que le manque du côté de l’intellect.
Si l’âme est rationnelle, son savoir est différent de celui de
l’intellect passif (patient). Le savoir de l’âme est individuel pendant
que le savoir de l’intellect patient est universel. Bien que l’homme soit sans
intellect à proprement parler, il est conjoint, uni (Muttahed, Muttassel)
à l’intellect patient par l’intermédiaire de son âme.
L’intellect patient est » séparable, impassible et non mélangé
» c’est-à-dire pure disposition pour recevoir, séparable
parce que ne faisant pas partie du corps, n’a pas d’organe, incorruptible contrairement
à l’âme qui est une forme et donc corruptible, impassible car reçoit
les formes de l’imagination sans danger quant à sa nature, » non
mélangé » car connaît les universels, acte impossible
pour une puissance du corps. L’intellect patient ne peut rien savoir sans l’aide
de la raison humaine.
Si en Islam l’acte de l’homme dépend de la volonté de Dieu, qu’il
se remet à Dieu pour son désir (c’est le sens du mot Islam : se
remettre à Dieu) et donc n’a pas son propre intellect agent, Averroès
va tenter une harmonisation. Il admet les deux principes aristotéliciens
(l’actif et le passif) pour en faire un seul, il dit dans son commentaire sur
l’Âme : » Quand on considère l’intellect matériel
et l’intellect agent, ils semblent être deux d’une façon et un
seul de l’autre. Car ils sont deux par la diversité de leur action :
l’action de l’intellect agent est de générer, celle de l’autre
est d’être informé. Mais ils sont un puisque l’intellect matériel
est perfectionné par l’intellect agent et le comprend. A partir de cela,
nous disons que parce que l’intellect est conjoint à nous, ils paraissent
être deux puissances en nous dont l’un est actif et l’autre étant
le genus des puissances passives. «
Ceci permet à Averroès d’affirmer que la connaissance
de l’homme mortel cesse avec sa mort alors que la connaissance de l’intellect
est éternelle.
La connaissance acquise (intellectus adeptus), en arabe (al-akl al-mustafad),
est celle résultant de la conjonction de l’intellect matériel
avec l’intellect agent, union finale de l’homme avec l’intellect agent, Dieu,
par la continuité de ses intelligibles avec l’intellect matériel.
Averroès conclut son travail en citant Thémistius pour dire que
l’union finale est la manière de l’homme de devenir semblable à
Dieu par son savoir : » Ainsi, comme Thémistius dit, l’homme
est assimilé à Dieu, car d’une certaine façon il est
et il sait toutes choses car les choses ne sont rien d’autre que son
savoir et que la cause des choses n’est rien d’autre que son savoir. Comme cet
ordre est merveilleux et que ce monde d’existence est extraordinaire. «
(De Anima)
Voilà ainsi la félicité, l’harmonie et la jouissance de
Ibn Rushd.
Mais que fait-il des hommes et des femmes ? Que fait-il de la dysharmonie ?
Comment faire pour que cet homme nous parle de ce qui tracasse tout le monde
? Pour trouver quelques indications je suis revenue à la logique d’Aristote
par les commentaires qu’en a fait Ibn Rushd, en passant d’abord par le commentaire
de la République de Platon qu’Ibn Rushd a fait, n’ayant pas réussi
à trouver une copie de » la Politique » d’Aristote, dont il
fera une lecture aristotélicienne.
» Nous savons, dit Ibn Rushd, que la femme, en tant qu’elle
est semblable à l’homme, doit nécessairement partager les fins
ultimes de l’homme, bien qu’il y ait entre eux des différences en plus
ou en moins […]. Si la nature de l’homme et de la femme est identique
et que toute constitution de même type doit déboucher sur une
activité sociale précise, il est alors évident que dans
ce modèle la femme doit accomplir les mêmes tâches que l’homme
[…]. Quand certaines femmes ont reçu une excellente instruction et
montrent des dispositions remarquables, il n’est pas impossible qu’elles
deviennent philosophes ou dirigeantes […]. Dans nos sociétés,
cependant, les capacités des femmes sont méconnues car on n’utilise
celles-ci qu’en vue de la procréation, aussi sont-elles placées
au service de leurs maris et les activités dans lesquelles on les cantonne
consistent à mettre au monde, à élever et à éduquer
les enfants, etc. «
N’est-ce pas ? » elles sont identiques « , les mêmes,
en plus ou en moins… Nous verrons plus loin les incidences actuelles de ces
assertions.
Passons tout de suite ou revenons à la logique et au livre qui commente
le syllogisme (al Oyas) ou » Les premiers analytiques » d’Aristote
commentés par Averroès.
Je parlais au début du sentiment de malaise que j’avais à lire
ce type de textes qui réduit les énonciations à une suite
d’énoncés, les dire à des dits, alors que mon attention
flottait et que je ne comprenais plus ces propositions accouplées deux
par deux, remplacées par des lettres a, b, g, d. Un texte surgit vers
la fin de ce livre, dans un chapitre consacré à la conversation
en logique et qui met en avant ce qui est préférable de faire
et ce qui est à éviter. L’éthique aristotélicienne,
c’est cela : ce qu’il vaut mieux faire, le Bien. Donc un texte surgit et me
réveille de mon cauchemar syllogistique et j’ai alors l’impression de
rêver. C’est comme un achoppement qui fait sortir, comme en analyse, ce
qui tracasse l’analysant. Un dire vrai, il appelle ça, Lacan.
Du coup, j’ouvre les yeux, je lis et je n’en crois pas mes oreilles si j’ose
dire. Et je me dis : voilà, c’est ça, ça ne pouvait être
que cela, la chute du syllogisme qui m’ennuie tant. Le symptôme. Toute
ma lecture d’Averroès me faisait souçonner quelque chose de cet
ordre, mais qu’il soit là devant mes yeux, je sautais de joie. Ibn Rushd
évoque ici la question du rapport sexuel. Il commente Aristote et nous
dit que ce dernier se réfère à Platon (ce qu’Aristote ne
nous dit pas), au Banquet précisément. Pour illustrer le préférable
à faire, Aristote parle du couple de l’amant et de l’aimé pour
illustrer la conversation en logique partant de la question d’appartenance qui
peut se traduire en extension par trois sphères ou trois ronds. Pour
simplifier : » Tout homme appartient au monde animal » : tout a est
b. » Tout animal appartient aux vivants » : tout b est g. Moyennant
quoi : tout a est g.
Nous avons ainsi un couple d’extrêmes plus un moyen.
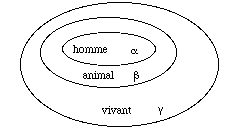
Aristote touche du doigt qu’il faut qu’il y en ait trois, intuition
du noeud à trois, mais il s’imagine qu’ils tiennent deux par
deux, ce qui fait que les trois soient concentriques.
Abordons le texte L’Organon, Les premiers Analytiques : Livre II, paragraphes
68 a et 68 b, dans le commentaire d’Averroès, c’est le chapitre 10.
A est préférable à b (b est à éviter)
D est préférable à G (G est à éviter)
» Si donc tout amant, en vertu de son amour préfère A (savoir
que l’aimé soit disposé à lui accorder ses faveurs),
sans toutefois les lui accorder (G) plutôt que de voir l’aimé lui
accorder ses faveurs (D), sans être disposé à les lui accorder
(b). Il est évident que A (l’aimé est disposé) est d’une
nature telle qu’il est préférable au parti de se voir accorder
les faveurs de l’aimé. Être aimé est donc, en amour, préférable
à l’union charnelle (trad. de Tricot). L’amour dépend ainsi plus
de l’affection que de l’union charnelle. Et si c’est par dessus tout, être
aimé qui importe, c’est là sa fin (visée). L’union
charnelle n’est donc absolument pas une fin, ou ne l’est qu’en vue d’être
aimé. »
» Et, conclut-il, en effet, les autres désirs et les arts se comportent
de la même manière. » (L’organon d’ Aristote traduit par J.
Tricot, éd. Vrin).
Averroès explicitera la référence d’Aristote à
Platon et traduira l’union charnelle (suneinaï, en grec) par al-jama
en arabe qui veut dire littéralement assemblage, et aimer (filetd en
grec) par Ahabba en arabe la disposition qui témoigne d’être
aimé, carizegnai.
Voilà donc la chute, le symptôme qui supplée à l’absence
du rapport sexuel. En découvrant ce texte, je croyais découvrir
l’Amérique, comme Christophe Colomb, actuellement célébré,
j’apprends alors que Lacan l’avait déjà déniché
il y a une vingtaine d’années. Il en parle dans son séminaire
Les non-dupent errent. Loin d’être déçue, c’est à
mon tour l’harmonie… Car je retrouve là mon » même »
et mon » mâme » à propos de ce texte. Lacan qualifie
la logique par la science du Réel. A cause de ce trois des trois
propositions d’Aristote.
Le surgissement ici, nous dit-il, est absolument caractéristique. Ce
qui résulte de ce syllogisme de la conversion, c’est que le souneinaï
vaut moins que cette bonne disposition qui témoigne d’être aimé.
Ce surgissement est caractéristique de l’amour en tant qu’homosexuel,
et une chose tout à fait frappante concernant l’irruption au milieu de
ce que j’ai défini comme étant ici articulé comme la science
du Réel… une chose qui est vraiment l’irruption du vrai, et d’un vrai
qui est justement un vrai dont il n’y a en fin de compte, que l’approche, puisque
le problème dont il s’agit est justement celui d’un amour qui ne concerne
que par l’intermédiaire de la jouissance, du souneinaï dont
il s’agit, à savoir d’une jouissance parfaitement localisée et
homologue, homogène, celle qui fait qu’en fin de compte, s’il y a, en
effet quelque chose que permet la non existence du rapport sexuel comme tel,
c’est très précisément que l’homoïos (omoioV)
en est assurément quelque chose comme un pas qui confirme, qui appuie
la non existence du rapport. La filiation, de filix c’est ce qui représente
la possibilité d’un lien d’amour entre deux êtres. » C’est
au courage de supporter, dit Lacan dans Encore, la relation intolérable
à l’être suprême que les amis, filoi, se reconnaissent et
se choisissent. « L’hors-sexe de cette éthique est manifeste.
C’est pourquoi une femme peut être conduite vers l’hystérie, c’est-à-dire
à faire l’homme, être elle-même hors-sexe, homosexuelle.
Cette question, nous dit Averroès, a été probablement
choisie par Aristote, parmi tout autre pour illustrer le préférable
par la proximité de sa nature de celle du syllogisme, de l’esprit du
syllogisme, c’est-à-dire, dit-il par son caractère généralisable.
L’idéal est donc bien pour Aristote et pour Averroès un idéal
d’impassibilité, d’être pure disposition comme c’est le cas avec
le Dieu immobile.
Ce qui supplée donc au rapport sexuel, c’est l’amour, c’est l’amour
qui vise l’être, être disposé, être aimé, cet
être tout près du signifiant m’être, S1, signifiant maître.
Ce dire vrai, cet achoppement, c’est le savoir en tant qu’inconscient, qui
réussit à se faire entendre pour suppléer à l’absence
de tout rapport entre l’homme et une femme. C’est là la différence,
nous dit Lacan, qu’il y a entre le dire vrai et la science du Réel.
Et pour une femme ça ne va pas, ça ne va pas sans dire. J’espère
avoir été assez sage et raisonnable.