
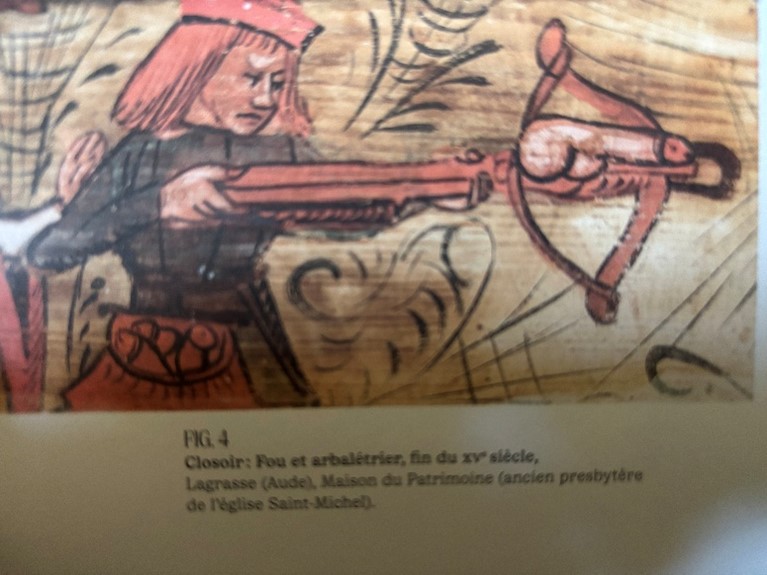
Comme je pense qu’il est clair pour tous, nous sommes sur un terrain assez glissant et, pour réduire les risques de chutes ruineuses, je vais prendre deux appuis, qui sont les suivants, et que, évidemment, j’ai cherché du coté de Lacan : Quelque chose est éludé dans la proposition de la logique mathématique, à savoir la question de ce qu’il y a d’initial, d’initiant, à poser un signifiant quelconque, à l’introduire comme représentant le sujet.[1] Et l’autre : Et qu’en tout cas la fonction du tout trouve son assise, son point tournant originel et, si je puis dire, le principe même dont s’institue son illusion dans le repérage de l’objet perdu, dans la fonction intermédiaire de l’objet “a” entre le signifiant originel en tant qu’il est signifiant refoulé et le signifiant qui le représente dans la substitution qu’instaure la répétition, elle-même première.
Les risques restent de toutes façons là et je vais commencer par prendre le risque de nommer notre embarras, qui évidemment, ne manque pas d’être singulier, passé au peigne fin de la singularité. Ça m’arrive d’être blanc, mâle, hétérosexuel et, en plus psychiatre. Je crois me rappeler que c’était André Breton qui disait que dans chaque psychiatre il y a quelque chose du policier. Bon, il y a de quoi être réduit au silence, rien que par la force de ces faits.
Le point est qu’ils ne sont pas des faits. Je ne vais pas vous encombrer avec la critique du néopositivisme de Wittgenstein, mais ils ne sont pas des faits. Ils sont d’abord des signifiants. La preuve en est que ça m’arrive d’être l’objet d’un transfert par des hommes, des femmes, des noirs, des homosexuels, des non binaires.
Or, m’appuyant sur mes deux appuis de sûreté, je vais commencer par remarquer que, comme vous le savez, un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. En plus, ce signifiant, celui qui se trouve représenter le sujet pour un autre signifiant, a en soi quelque chose d’initial, d’initiant.
C’est donc avec une certaine surprise que le sujet se trouve – se recouvre, plutôt que se découvre ou se retrouve – à être représenté par un signifiant auprès d’un autre signifiant. La conscience enregistre, elle ne fait qu’enregistrer ; c’est le résultat d’un processus germinatif, initial, qui reste, et qui est destiné à rester, sous la barre du grand Autre. Cela peut se produire, car le signifiant en germination se laisse reconnaitre par un effet : un émoi, une émotion, un acting out, un passage à l’acte ; jusqu’à l’angoisse. Lorsque nous essayons de faire face à cet effet, lorsque nous cherchons une explication pour l’effet dont nous sommes les témoins, nous essayons de pécher un deuxième signifiant qui est celui pour lequel le sujet se trouve représenté par le premier, par le signifiant germiné.
Que le signifiant ‘genre’ (gender) puisse être banni du langage de la science américaine dans ou par un acte symptomatique, représente donc un sujet pour un signifiant ; mais lequel ? Le signifiant pour lequel un sujet est représenté par le signifiant ‘genre’ nous pouvons dans ce cas l’imaginer comme une culture qui verrait le sexe comme une division parfaite, sans reste : Dieu créa donc l’homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu, et il les créa mâle et femelle.[2] Il n’est pas difficile d’imaginer le frisson de gêne, sinon d’horreur, qu’évoque le mot ‘genre’ dans la culture qui vient directement du ku klux klan et de la Bible Belt. C’est la même culture que, paradoxalement si vous voulez, faisait dire à von Schirach : « Lorsque j’entends le mot culture, je porte ma main au pistolet. »[3]
Toute autre histoire est que le signifiant pour lequel le sujet est représenté par le signifiant ‘genre’ est en revanche une culture genderfree, non binaire, qui souhaiterait plutôt l’épanouissement de la personne, de l’Homme avec grand H, du sapiens, finalement libre de l’imposition d’une subjectivation sexuée. Là, il s’agirait, et il s’agit en effet d’autres actes symptomatiques.
J’ai mon opinion, et je dis bien mon opinion, donc une doxa, une pensée civile, politique, qui me concerne en tant que citoyen. Puis-je faire comme si je n’en avais pas une ? Non. Mais si la demande est si je peux m’abstenir, si je peux faire un pas en arrière par rapport à ma propre opinion et libérer ainsi quelque chose de la possibilité d’une écoute analytique, alors, non seulement la réponse est oui, mais c’est exactement ce que la psychanalyse demande comme position éthique de la part d’un analyste : aller vers le réel plutôt que vers l’idéal, l’irréel, l’utopique.
D’une chose nous sommes relativement sûr : l’idéal est fait pour être manqué. Que ce soit l’Homme nouveau, le sapiens libre de l’imposition sexuée, que ce soit La Femme, la toute femme, une des Sœurs[4], n’est-ce pas ? Ou que ce soit le mâle version machiste, l’idéal est toujours manqué. Autrement dit, nous sommes divisés. C’est un fait de structure qui fait de nous-mêmes des êtres désirants.
Pour m’expliquer un peu mieux, je vais reprendre à partir de ce point de vue, la tragédie d’Antigone. Antigone ne participe pas à la vie de la cité, elle est déjà morte à la vie politique et sociale. La décision de Créon, les funérailles d’Etat pour Étéocle et le cadavre de Polynice laissé à la corruption, met Antigone devant sa division : il y a quelque chose de Polynice en Étéocle, et il y a quelque chose de Étéocle dans Polynice. Les deux ne sont pas totalement séparables. D’ailleurs les quatre enfants d’Œdipe et de Jocaste sont les seuls à avoir été arrachés à leurs enfance heureuse par le savoir qui a fait d’eux-mêmes les frères et les sœurs de leur père et le petits-fils et filles de leur mère. Savoir donc qui jette les quatre enfants hors de la Cité, qui les met hors de la loi constitutive de la Cité, de la civilisation et du lien social. Les quatre, en somme, ne sont pas des animaux politiques. C’est pour cela qu’Antigone ne comprend pas la décision politique de Créon. C’est à Créon que revient la charge, le devoir d’un choix politique, un choix basé sur la force imaginaire et symbolique du deux : Étéocle et Polynice, le bon et le mauvais. Il n’en est pas ainsi pour Antigone. Malgré son nom qui semble l’inscrire dans une position ‘anti’, d’opposition, pour elle il n’est pas question de la force du deux. Polynice n’est pas le mauvais et Étéocle n’est pas le bon. Plutôt il y a Étéocle dans Polynice et il y a Polynice dans Étéocle.
Cette question de la logique du deux, n’est pas sans évoquer la lutte entre le maitre et l’esclave, lutte politique dans la conception de Hegel et de Marx, moteur de l’histoire pour Hegel et, tout compte fait, aussi pour Marx, pour lequel la plus-value était destinée à disparaitre avec le Communisme. C’est Lacan qui nous dit que non, la plus-value ne va pas disparaitre malgré la Révolution. Elle est plutôt l’homologue du plus-de-jouir qui est lié à la présence inéliminable de l’objet. C’est la logique de la structure, logique de la singularité, logique du discours, logique borroméenne à laquelle nous sommes confrontés.
Apparemment nous aussi, nous les psychanalystes, nous avons deux façons logiques, algébriques, de faire valoir la présence de l’objet : coté homme et coté femme. Mais l’algèbre n’est pas la vie. Il le savait très bien Jorge Luis Borges qui nous parle, magnifiquement, de la mort comme du moment de rejoindre « l’algèbre de son miroir ».[5] Reste que du côté femme nous constatons qu’elle n’est pas toute et du côté homme on est tout, on peut essayer de l’être, au prix de devenir totalement imbécile : identifié au phallus plutôt que d’en être encombré.
Lacan est, à ce propos, très précis :
…tenons nous à la psychanalyse finie et disons qu’à la fin :
Autrement dit, comme il y a, à la fin, du psychanalysant dans le psychanalyste et du psychanalyste dans le psychanalysant, il y a de l’homme dans la femme et il y a de la femme dans l’homme. Nous ne marchons pas à la musique du deux. Sans être hystériques, nous sommes nécessairement du côté d’Antigone. Or, la position d’Antigone n’est pas une condition suffisante pour tenir une position analytique, mais elle est une condition nécessaire. En revanche, la position de Créon qui lui aussi, le pauvre, était divisé, empêche, en tant que position politique, de pouvoir se trouver à occuper la place de l’analyste ; il en était empêché par sa fonction.
Il est évident que cette position nous condamne, dans une certaine mesure, à être à l’écoute de la singularité. Le savoir sur lequel nous prenons appui, et qui n’est pas du même ordre que le savoir qui nous est supposé, il est plutôt un savoir sans objet, un savoir formalisé, algébrisé. C’est sa valeur et sa limite. Il ne faut pas s’attendre à ce que quelque chose d’initial, d’initiant, qu’un signifiant représentant le sujet, puisse y surgir. Là c’est du savoir inconscient qu’il s’agit. Comme Lacan nous le rappelle, notre logique mathématique « élude la question de ce qu’il y a d’initial, d’initiant à poser un signifiant quelconque… ».
Nous voilà, donc, à l’écoute d’une singularité qui ne permet aucune généralisation sinon dans le cadre d’une formalisation mathématisante.
C’est un vieux problème. Déjà Freud était parfaitement clair sur ce dont il s’agissait :[7]
La dépendance de cet écrit à l’égard des expériences psychanalytiques, qui ont stimulé sa composition, se démontre non seulement dans le choix mais aussi dans l’ordonnancement du matériel. Partout où l’on s’en tient à une certaine succession d’instances, les facteurs accidentels sont mis au premier plan, les facteurs dispositionnels sont laissés à l’arrière-plan et le développement ontogénétique est traité de préférence au développement phylogénétique. C’est-à-dire que l’accidentel a sa part principale dans l’analyse et est dominé par l’analyse presque sans résidus ; l’élément dispositionnel apparaît seulement derrière lui comme quelque chose qui doit être éveillé par l’expérience vécue, mais dont l’évaluation dépasse largement le champ de travail de la psychanalyse.
Donc, d’un côté l’écoute de la singularité et, en principe, nous sommes tous et toutes d’accord, mais reste la question de ce que Freud appelle « l’élément dispositionnel » et que nous avons l’habitude de prendre par le biais de la structure. Autrement dit : dans le déni, dans le démenti du réel sexuel, avons-nous à faire avec la perversion ? La question est évidemment pertinente, liée comme elle l’est, au déni de la fonction phallique, voir au déni de la castration.
À ce niveau nous avons deux questions, emboitées l’une dans l’autre. La première est d’ordre général : lorsque nous définissons la perversion comme le résultat d’un déni de la castration, on tombe assez vite dans un cercle vicieux pour lequel, si on dit perverse la formation déterminée par le déni de la castration, nous définissons le déni comme le mécanisme de défense qui origine une formation qu’on appelle perverse. Bien sûr il y a l’évidence phénoménologique de la formation qu’on appelle perverse, mais là il faut se résigner à laisser tomber l’aspiration de nommer quelque chose de l’ordre de la structure. La deuxième question est plus complexe et concerne le déni ou le déplacement de la fonction phallique. Est-ce qu’il s’agit vraiment de ça, ou n’est-il pas plutôt affaire de déni de la fonction du porteur du phallus ? La chute du patriarcat qui a accompagné le siècle dernier, malgré sa fâcheuse tendance à resurgir comme autocratie politique et comme acte potentiellement meurtrier, indique d’abord un malaise, un embarras à assumer l’encombrement d’en être le porteur, voire une difficulté à accepter que quelqu’un puisse en être encombré.[8]
Cela dit, nous continuons à être de créatures de langage, soumises pour ça à la fonction phallique. Mais dans l’impossibilité qui est la nôtre d’identifier son porteur, nous avons du mal à nommer notre soumission et nous cultivons et nous chérissons plutôt l’idée, voire l’idéal, de notre liberté.
C’est cette considération qui me permet de formuler aujourd’hui la difficulté que nous avons dans la direction de nos cures. Le transfert est la supposition d’un savoir à un sujet, voire la supposition d’un sujet à un savoir. L’analyste se charge, littéralement, d’incarner provisoirement le sujet auquel on suppose un savoir dans le transfert. Quitte évidemment à échouer de cette position. Je me rappelle d’avoir entendu Charles Melman dire il y a une trentaine d’années, que si on prenait en analyse un croyant, eh bien, les trois quarts du travail étaient déjà fait.
La flèche du transfert, dans le tétraèdre que Lacan nous propose dans L’acte analytique, va vers l’objet a, à savoir l’analyste, qui échouant de sa propre position de sujet supposé savoir, occupe la place du reste, de l’éponge tordue en attente d’un nouvel analysant qui puisse l’imprégner de ses attentes, de sa propre supposition.
Or, cette opération de supposition d’un savoir supposé, nécessite la croyance qu’un phallus a cessé de se balader car il aurait trouvé son porteur. C’est ça la difficulté : si on se met en condition de faciliter un transfert on se retrouve du côté de la suggestion, mais, de nos jours, si nous ne sommes pas en mesure de susciter un transfert, pas de supposition d’un savoir et donc pas de psychanalyse. Vous vous rappelez que le lieu du tétraèdre marqué du je ne suis pas, lieu, disons-le ainsi, visé par le transfert, est marqué par le -φ, par le signifiant phallique. Pas question de le viser, s’il n’a pas un porteur imaginé comme tel.
Une dernière remarque : s’il n’y a pas de transfert il n’y a pas non plus une tache qui permet un travail de construction. Laisser tomber le porteur du phallus, se retrouver avec l’objet a entre ses mains ; c’est ça qui fait qu’un psychanalysant peut devenir non pas un psychanalysé, mais un psychanalyste. Ne pas passer par cette chute et être plutôt dans la condition de faire face à l’objet dans la position qui lui est donné par le discours du Capital, produit en revanche le désêtre propre à de nombreuses figures de la Nouvelle Économie Psychique. Cela naturellement, et malheureusement, comprend aussi nombreux analystes, qui sont à la recherche d’un savoir technique, limité, opérationnel, un savoir auquel ne pas supposer un sujet. Ou mieux : des analystes qui pensent pouvoir se passer de cette supposition, car la supposition s’est déjà faite à travers leur militance, à travers leur opinion affichée. C’est ce savoir technique, opérationnel, non subjectivable, qui se charge de soutenir une pratique identitaire, aveugle, répétitive, sûre et rassurante.
[1] J. Lacan, L’acte psychanalytique, Séminaire 1967 – 1968, Édition de l’Association Lacanienne Internationale, Publication hors commerce, Leçon du 7 février 1968, p. 143 et, pour la deuxième, leçon du 13 mars 1968, pp. 227 – 228.
[2] Genèse, 1, 27.
[3] La phrase est en effet de l’écrivain Ferdinand von Schirach, petit-fils de Goebbels, et très souvent elle est attribuée erronément à Goebbels ou à Goering. La référence au nazisme n’est pas du tout arbitraire, au contraire elle est basée sur les donnés relatives aux années trente et quarante aux Etats Unis où il se produit une vraie attaque subversive à la démocratie américaine. Cfr. Rachel Maddow,, Prequel, 2023
[4] S. Lippi et P. Maniglier, Sœurs, Seuil 2023.
[5] Jorge Louis Borges, «Elogio dell’ombra», in Opere, Mondadori, Milano 1985, vol. II, p. 363.
[6] Jacques Lacan, L’acte psychanalytique, Séminaire 1967 – 1968, Édition de l’Association lacanienne internationale, Publication hors commerce, Leçon du 21 février 1968, pp 159 et 160.
[7] Trois essais sur la théorie sexuelle (Préface à la troisième édition, 1914)
[8] Ceci n’est pas sans rappeler ce que Frege note à propos de la négation : …une pensée fausse ce n’est pas une pensée non existente, même pas dans le cas où, pour être d’une pensée on entend le fait qu’elle n’a pas besoin d’un porteur. Gottlob Frege, “Die Verneinung. Eine logische Untersuchung.” Dans Ricerche logiche, il glifo, 2018, p. 61.