
Prenons comme point de départ de notre réflexion une question provenant d’un colloque de l’Association Freudienne Internationale sur le thème Traduction et Psychanalyse, ainsi formulée : En quoi la pratique de la traduction pourrait aider le psychanalyste dans sa formation ? Ce fût l’un des questionnements qui orienta nos premières réflexions sur la traduction. Mais, au cours des élaborations, nous avons suivi un fil directeur différent : celui de l’analysant et nous avons penché pour une autre recherche : quelle analogie nous pourrions rencontrer entre le traduire et l’expérience psychanalytique ? C’est sur cette deuxième question que nous allons nous attarder.
L’idée d’articuler le processus d’analyse avec le travail de traduction d’un texte part, probablement, de la référence « classique » à la Lettre 52 de Freud à Fliess. Dans ce document, daté du 6 décembre 1896, Freud fait référence à la psychoneurose comme découlant d’un échec de traduction. Il cherche à expliquer comment le mécanisme psychique se forme par un procédé de stratifications, dont le matériel, qui serait là présent comme trait de mémoire, serait sujet, de temps en temps, à un réarrangement découlant de nouvelles circonstances, ou soit, à une re-transcription. Il nous dit
« Je m’explique les particularités des psychonévroses en supposant que la traduction de certains matériaux ne s’est pas réalisée – ce qui doit entraîner certaines conséquences… » (1)
« C’est le défaut de traduction que nous appelons, en clinique, refoulement. Le motif en est toujours la production de déplaisir qui résulterait d’une traduction; tout se passe comme si ce déplaisir perturbait la pensée en entravant le processus de la traduction. » (2)
Nous pouvons alors déduire que quand une idée n’a pas été traduite, elle est refoulée dans un lieu autre, et reste dans l’attente d’une traduction. L’allusion à la Carte 52 est constamment reprise par les chercheurs spécialistes de l’évolution de ses théories. Mais s’agit-il, dans ce cas, de traduction au vrai sens du terme, ou l’usage de ce terme aurait-il un tout autre sens ?
Nous allons maintenant approfondir la question : qu’est ce que traduire?
Traduire est reformuler un message, en l’écrivant et en le transmettant dans une langue différente de celle dans laquelle il a été écrit, conçu, à l’origine. La traduction ainsi perçue est considérée, selon Paulo Ronai, comme interlinguale (3). Les étudieux de la traductologie (4) excluent de la catégorie de traduction, toute autre opération intellectuelle à laquelle le terme de traduction puisse être appliqué au sens figuratif. Cependant, pour nous, psychanalystes, qui travaillons la traduction, il est important de rappeler qu’il y a d’autres reformulations de messages qui surviennent non pas entre différentes langues mais entre différents langages. Nous pouvons alors avoir : la traduction intra linguale, sociolinguistique, intersémantique, etc. Toutefois, cette dernière est une forme figurée pour parler de traduction.
Pour Novalis, « toute poésie est traduction » (4), Schlegel y ajoute, « de la langue des dieux » (5). Ainsi, de même la musique est considérée comme une forme de traduction (intersémiotique) ; ou encore une idée non élucidée, lorsqu’elle se transforme en mots, est traduction (intralinguale) (6). Par conséquent, en suivant Paulo Ronai, nous pouvons affirmer que le terme traduction, chez Freud, serait utilisé au sens figuratif, dans une analogie, par approximation. Chez Freud, il ne s’agit pas d’une traductologie inter linguale, traduction d’une langue à une autre, comme nous avons vu ci-dessus, mais d’un langage à un autre : le langage du désir.
Nous avons rencontré mille analogies en se focalisant sur ces deux domaines, ainsi, c’est fréquemment que Lacan fait allusion à la traduction ou à l’écriture, tout au long de son oeuvre. Mais, essayons de conduire notre discours, ici, et de délimiter notre champ d’étude dans cet entre deux : ni entre une langue et une autre, ni entre un langage et un autre, mais entre le domaine de la traductologie et de l’expérience psychanalytique, dans ce va et vient par lequel l’analogie nous sera peut-être profitable. Voyons maintenant
De l’une à l’autre : Traduction vers expérience psychanalytique
Quels seraient les cheminements de base à suivre, dans le travail du traducteur ?
Face au texte, le traducteur aurait d’abord deux possibilités : mener le lecteur vers l’auteur, ou en somme, donner la priorité à la langue d’origine ; ou mener l’auteur vers le lecteur c’est-à-dire donner la priorité à la langue d’arrivée. Dans le premier cas, c’est-à-dire quand le traducteur, en accordant la priorité à la langue d’origine, choisit comme maître exclusif, l’auteur, l’oeuvre ou la langue étrangère, ayant pour ambition de l’imposer en conservant son étrangeté dans son propre espace culturel, il prend le risque d’apparaître comme un étranger ou de trahir sa langue, aux yeux des ses compatriotes. D’un autre côté, s’il a du succès ou s’il est reconnu, rien ne garantit que l’autre culture ne se sente pas volée et privée d’une oeuvre qu’elle pensait lui appartenir. En contrepartie, si le traducteur penche pour la deuxième possibilité, privilégiant le public lecteur, soit la langue d’arrivée, il va certainement réussir à satisfaire la partie la moins exigeante du public, toutefois, il aura peut-être trahi l’œuvre étrangère, et naturellement l’essence du texte à traduire.
Ceci nous permet de constater que, en commençant ce travail de longue haleine, le traducteur va toujours occuper un espace entre deux, osciller, par choix, entre le sens ou la lettre, la langue d’origine ou celle d’arrivée. Mais quelles analogies pourrions-nous rencontrer entre ce mouvement et l’expérience psychanalytique ?
Et bien, l’analysant sera aussi dans un entre deux : entre la langue maternelle et l’Autre, l’étrangère. Pourtant celle-ci est d’une bizarrerie radicale, qui naît d’un non-savoir qui l’habite, provenant non seulement d’un lieu Autre, mais de ce qui manque en lui – ![]() . Il s’agit ici d’un non-savoir radical, celui du manque de l’Autre, qui ravit l’analysant et le dérange. C’est dans cet entre deux que se passe tout le drame de l’analyse. Cependant, nous avons ici une différence clé (7) : si un traducteur demeure dans une langue ou une autre en oscillant par choix, l’analysant de son côté, vacille mais sans choix. Pour le psychanalysant c’est l’une qui envahit l’autre, en brisant les frontières, obligeant alors à reconstruire les bords, dresser le non-savoir, en renouvelant et en repassant la barre.
. Il s’agit ici d’un non-savoir radical, celui du manque de l’Autre, qui ravit l’analysant et le dérange. C’est dans cet entre deux que se passe tout le drame de l’analyse. Cependant, nous avons ici une différence clé (7) : si un traducteur demeure dans une langue ou une autre en oscillant par choix, l’analysant de son côté, vacille mais sans choix. Pour le psychanalysant c’est l’une qui envahit l’autre, en brisant les frontières, obligeant alors à reconstruire les bords, dresser le non-savoir, en renouvelant et en repassant la barre.
Pour en revenir alors à l’étude des réactions adverses du milieu, face à la traduction de ses oeuvres, dans le cas où on privilégie la langue d’arrivée, cela vaut la peine de souligner que le public du XVIe siècle (8) se réjouissait en lisant une oeuvre dans ses variantes linguistiques, dans ses différentes langues. Public qui ignorait la problématique de la fidélité ou de la trahison. Pourquoi ? Nous pouvons dire que, du fait du plurilinguisme, ce public ne sacralisait pas sa langue maternelle, par conséquent, ne résistait pas à ce qu’une oeuvre passe d’une langue à une autre. (9)
Cela nous mène à la question des résistances. Selon Antoine Berman, nous aurions deux types de résistances à la traduction
Résistance provenant de la culture : toute culture résiste à la traduction, même si elle en a vraiment besoin. Le propre idéal de la traduction, qui viserait à ouvrir, au niveau de l’écrit, une certaine relation avec l’Autre, féconder, alimenter ce qui lui est Propre par la médiation de l’Étranger, va à l’encontre de la structure ethnocentrique de toute culture, soit, de cette sorte de narcissisme qui fait que toute société veut être un Tout pure et sans métissage.
Toute culture prétendrait, en ultime recours, être auto-suffisante, se suffire à elle-même, et à partir de cette suffisance imaginaire, exercer une domination sur les autres cultures. Cette réflexion contient une autre question : Est-ce vrai que toute culture résiste réellement à la traduction ?
Il serait peut-être valide de faire une observation sur les particularités inhérentes à chaque culture. Pouvons-nous dire, par exemple, que ceci est aussi vrai pour la culture brésilienne que pour la culture française ? Ne serait-ce pas, par le propre métissage, comme par l’héritage culturel du peuple ou encore par la propre colonisation, qu’il y a, au Brésil, une culture plus ouverte à l’étranger ? Il faut faire ici une parenthèse : cela ne nous rapprocherait-il pas de la psychanalyse, et/ou d’une plus grande ouverture pour passer par le féminin ?
Résistance culturelle du traducteur : on observe parfois une déformation qui s’opère au niveau linguistique et littéraire et qui conditionne le traducteur, qu’il le sache ou non, le rendant toujours passible d’un immersion dans la dialectique, entre fidélité et trahison. Dès lors, une constante oscillation s’opère : d’un côté, voulant obliger sa langue à se répandre dans l’eacute;trangeté, et d’un autre côté cherchant à l’ autre langue en se référant à sa langue maternelle. Ce réseau d’ambivalences tend à fausser la perspective authentique de traduction, pouvant amener le traducteur à pencher occasionnellement pour un système idéologique déformateur, ayant tendance de plus à le renforcer.
Par conséquent, la majeur partie des chercheurs spécialistes de ce thèmes, soutient que l’éthique de la traduction doit être celle du dialogue, de l’ouverture, du décentrement. Ainsi, nous pouvons conclure que traduire c’est, par essence, écrire et transmettre, mais le véritable sens de cette écriture et de cette transmission dépend de la perspective éthique qui les régit (10). Il est important de considérer l’existence des valeurs idéologiques et littéraires qui peuvent détourner la traduction de son but. Malgré cela, souvent la difficulté à choisir entre la littéralité et la liberté, le sens et la lettre, la prédominance de la langue d’origine ou d’arrivée, n’est pas synonyme de glissement méthodologique, mais la perception de contradictions et de difficultés fondamentales de la traduction et l’intuition de ce qui est possible et nécessaire de faire à un moment donné. Ceci échappe à l’analysant. Il ne lui est pas donné la liberté de glisser, par choix, d’un langage à l’autre.
Nous pourrions alors reprendre notre premier questionnement, en soulignant un aspect réellement positif qui découle de la traduction d’un texte et qui est d’une extrême importance pour l’analyse : au moyen de la traduction, des structures de l’écrit qui étaient auparavant cachées deviennent manifestes ; d’autres possibilités, latentes, jusqu’à lors méconnues, parfois un versant ou une version qui n’apparaissait pas dans l’original. Ceci peut mener à un enrichissement du texte. De ce point de vue, l’analogie entre la traduction et le procédé d’analyse est claire, de surcroît, c’est ici l’un des résultats positifs pour le psychanalyste qui travaille avec la traduction. Nous croyons que la pratique de la traduction peut le mener à une meilleure écoute des possibilités du dire, de l’étymologie, du double sens des mots, tout comme à une vision plus aiguë des autres significations qui avaient disparu ou avait été enterrées, atterrées tout comme le déchiffrage de lettres énigmatiques ou les charades instruisent aussi bien dans le maniement avec le langage du désir, langage métaphorique. À cet égard, n’oublions pas les titres que Lacan donne à ses derniers séminaires.
De l’un à l’autre : Du désir du sujet au désir de l’autre
Il est important que nous observions que toutes les connaissances, qu’elles concernent les différentes langues ou les autres formes de langage, naissent du lieu du code, du champ de l’Autre. Y résident non seulement les lois du langage, la synchronie et la diachronie, mais aussi bien les lois qui régissent la structure d’une langue, sa syntaxe, tout son matériel sémantique, les signifiants et les signifiés, ou encore chacun des phonèmes, etc.De plus, c’est aussi dans l’Autre que résident les mécanismes basiques des formations de l’inconscient : condensation et déplacement, ceux-ci, si bien explicités par Lacan, similaires à la métaphore et à la métonymie. Tout comme c’est encore dans ce lieu qu’habitent les signifiants qui nous permettent d’être représentés en tant que sujets désirants, pour un autre signifiant.
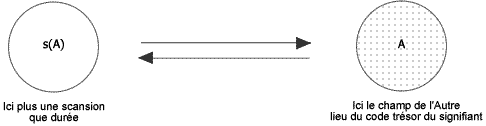
Dans le lieu du code (A) nous rencontrons tout le matériel avec lequel le langage doit travailler. Pour le traducteur, dans ce dernier, il rencontre les signifiants des langues, tantôt de la langue maternelle, tantôt de la langue étrangère. Pour l’analyste, à côté de ceux qui nous font parler, communiquer, s’exprimer, vont aussi se présenter, ici, les signifiants du désir inconscient – comme produit de la cure analytique, ou comme formation de l’inconscient, effet du travail de la lettre.
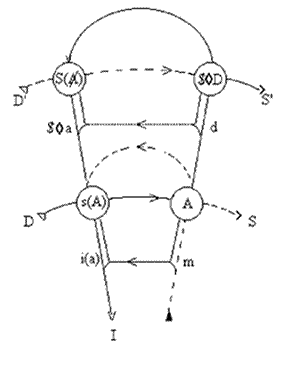 Passons maintenant à l’artifice du graphe du désir.
Passons maintenant à l’artifice du graphe du désir.
N’importe quel langage que ce soit, habitera le champ de l’autre. Pas seulement les signifiants linguistiques, les mots, tous les tropes, vocables et phonèmes qui peuplent le lexique et le référentiel sémantique de chacun – aussi bien de la lange maternelle que de la langue étrangère que je connais – mais aussi les signifiants qui alors viendront représenter le sujet désirant.
Tout ce qui fût régit et modulé par ce qui est au deuxième étage du graphe, dans le vecteur régit par la composition fantasmatique – ![]() -> d – et qui apporte les marques inscrites et modulées par l’histoire de chacun.
-> d – et qui apporte les marques inscrites et modulées par l’histoire de chacun.
Toutefois, le désir inconscient saillie toujours d’un désir Autre, et celui-ci m’est totalement étranger. Il advient moyennant le travail de la lettre, qui dans l’Autre fait un trou tissant la bordure d’un non savoir radical, ![]() , sur le chemin duquel se réinscrit l’histoire.
, sur le chemin duquel se réinscrit l’histoire.
Alors, en cherchant à établir une analogie avec les difficultés rencontrées par le traducteur, nous pourrions penser, ici, aux résistances de l’analysant dans un processus d’analyse
– à la résistance qui advient du traducteur, nous pouvons la faire correspondre à la résistance de l’analysant, originaire du désir inconscient, fruit du refoulement secondaire, nuancé par son histoire singulière et modelé par la composition fantasmatique. Ce désir inconscient – ou lettre clamant pour être lue – peut être symbolisé par un signifiant, représentant le sujet désirant face à l’autre signifiant, ayant sa signification dé-voilée et dépassé moyennant un effet de vérité.
– en ce qui concerne à la résistance de la culture – soit, que la culture résiste à la traduction – nous pourrions faire allusion à la castration, à travers laquelle un signifiant, le Nom-du-Père, exerce une fonction supportant un non savoir radical, permettant non seulement que s’inscrive un manque (le au-moins-un qui manque au niveau des signifiants), mais aussi bien que par elle on passe et l’on repasse. Ce signifiant, inscriptible toutefois imprononçable, comme le nom de Dieu, IAVH, indique le Réel, l’impossibilité de lecture, impossibilité de mot. Cela provoque, pour peu que l’on cherche à faire un tout, l’impossibilité de tracer les bordures du trou du savoir. D’où, les travaux de l’analyste et du traducteur se concluent bien diversement.
Alors, si le traducteur travaille avec un code autre, d’une langue étrangère ou d’un langage étranger, le psychanalysant va travailler avec la loi du désir, avec le langage du désir inconscient. Passer d’un langue à une autre, ou être représenté par des signifiants, implique toucher du doigt l’étranger, passer par l’étranger. Néanmoins, l’un est la traduction d’une langue vers une autre. Mais, dans l’autre cas, en ce qui concerne l’analyse, qu’est-ce qui serait traduit ? Et encore que le psychanalysant cherche la signification, que dire de l’analyste ?
Mieux vaut-il alors s’en tenir au fait que la conception freudienne de « traduction » d’un système à un autre est bien liée, initialement, à l’idée de rendre conscient tout le matériel inconscient, cependant qui s’accorde bien à la recherche d’un tout, le Un plotinien ? Face à la découverte et l’élaboration de l’inconscient par Freud, nous devons mettre en avant la systématisation consécutive donnée par Lacan, avec la théorisation sur le manque de l’Autre, ![]() (11), ce qui nous permet de la désigner comme la passe de Lacan vers Freud. Lacan, avec les recours qui lui sont fournit pour le développement de la logique contemporaine, va donner la priorité à la dimension de la coupure, de la lettre.
(11), ce qui nous permet de la désigner comme la passe de Lacan vers Freud. Lacan, avec les recours qui lui sont fournit pour le développement de la logique contemporaine, va donner la priorité à la dimension de la coupure, de la lettre.
Alors, plus explicitement de Freud à Lacan, serions-nous face à une traduction ou face à une production ? Surtout, serions-nous face à une écriture ou une réinscription par le mot ? Est-ce qu’avec Lacan, l’analyste vise la signification, ou est-ce le sans sens qu’il produit ?
Traduction ou écriture ?
Dans le processus d’analyse, on transite cependant dans ce va-et-vient, du désir du sujet au désir de l’Autre, et vice et versa. En désirant le désir de l’Autre l’analyste supporte sa fonction, fait circuler la lettre, mettant au travail la structure. S’en suit alors, tout un défilé des constructions fantasmatiques. La lettre, missive fermée dont le message, comme dans les contes de Poe, n’est jamais lue, alimente toute la trame, faisant en sorte que l’on passe et repasse par le non savoir radical. En tournant constamment, elle accomplit sa mission, arrive jusqu’à sa destinée … Ici, à la différence du traducteur, il n’incombe pas à l’analysant de choisir librement entre un langage et un autre ; mais à peine, étant habité par la lettre, de subir ses effets, et la laisser travailler.
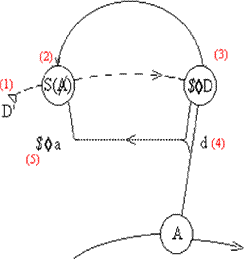 Nous observons, dans le graphe ci-dessus, utilisé par Lacan dans son séminaire Le désir et son Interprétationqu’en suivant la numération s’accomplit un trajet circulaire, qui partant du Che vuoi, l’évocation du désir de l’Autre, mène au désir du sujet, au moyen de la construction fantasmatique.
Nous observons, dans le graphe ci-dessus, utilisé par Lacan dans son séminaire Le désir et son Interprétationqu’en suivant la numération s’accomplit un trajet circulaire, qui partant du Che vuoi, l’évocation du désir de l’Autre, mène au désir du sujet, au moyen de la construction fantasmatique.
Lacan nous dit, dans le séminaire D’un autre à l’Autre (12), que « supporter l’affrontement du questionnement du sujet-supposé savoir est le passage essentiel, dépassant les arguments qui viendront de là « . Cependant, une optique lacanienne, dans l’expérience psychanalytique, il s’agit non pas de traduire la signification des mots, ni de donner la priorité aux arguments, mais de laisser travailler l’écrit, laisser opérer la fonction.
D’après Lacan, la dimension de la coupure, de la lettre parcourant un chemin, a la priorité. Par effet de transfert, au moyen de n’importe quel signifiant, la lettre commence son travail … Et s’en suit, en passant, non pas de main en main comme la lettre de Poe, mais, de signifiant en signifiant, en faisant tout tourner autour d’elle. La lettre, missive d’amour au père, va tracer la bordure du trou dans le savoir, en creusant le vide de l’être dans la texture du discours … Qu’elle travaille et qu’elle accomplisse sa mission et que grâce à cela se passe la passe, et que l’on en soit averti.
En guise de conclusion, quelques pistes de recherche : on traduit d’une langue à une autre ? D’un langage à un autre ? Ou en forçant l’impossible, on passe et repasse par la frontière du non savoir radical où la logique se distingue de la grammaire ?